La repentance des bourreaux : Un imbroglio politico-éthico-religieux ?
En général, au lendemain d’un crime de masse les tueurs n’avouent pas, ils s’abritent derrière le déni, le mensonge ou l’argument de la soumission à l’autorité.
L’échange est souvent stérile avec les auteurs de crimes de génocide ou alors il reste difficile en raison des stratégies de dénégation et des enjeux de défense personnelle avant un éventuel procès. Toute parole publique représente potentiellement un risque aussi bien d’un point de vue pénal que d’un point de vue social pour des crimes qui relèvent de l’imprescriptible. La journaliste et écrivain Gitta Sereny a été l’une des premières à recueillir les confidences de Franz Stangl, le commandant de Treblinka. Trente ans après les faits, le criminel nazi restait incapable de voir dans ses victimes autre chose qu’une « cargaison ». Lors de son dernier entretien, il évoquait pour la première fois sa culpabilité. « Ma faute, ma faute… » disait-il sans pouvoir aller au-delà. Il est mort dix-sept heures après d’une crise cardiaque[1].
La dimension religieuse et le recours à la notion de pardon pourraient-ils avoir des répercussions politiques ? Au Rwanda, de 1996 à 2006, 146 000 aveux de participation au génocide auraient été enregistrés dans les prisons et pour moitié sur les collines[2]. Si l’aveu et la demande de pardon apparaissent intimement liés, la frontière reste difficile à établir entre ce qui relève de la loi ou de la foi. Les détenus adhèrent-ils aux principes énoncés uniquement pour bénéficier des avantages de la loi (le plaider coupable et la promesse de relaxe) ou par conviction religieuse pour soulager leur conscience et obtenir le salut ? Dans certains cas, probablement un peu des deux, ou alors, tout simplement pour « se tirer d’affaire » et sortir de prison, à plus forte raison que la notion de pardon est communément associée à la suppression du châtiment. La volonté de « purifier son cœur », et plus encore la « peur de l’au-delà » reviennent comme des leitmotiv au cours des entretiens avec les détenus, certains leaders religieux les utilisent comme un moyen de pression.
Au Cambodge, lors du procès de Douch on retrouve cette ambiguïté et l’hybridation du religieux au politique et inversement. Converti au christianisme dans les années 1990, l’ancien responsable du centre de détention et d’exécution S-21 reconnaît l’essentiel de ses forfaits et la nature criminelle de l’idéologie qu’il servait. Contrairement aux quatre autres dirigeants khmers rouges dont le procès a débuté en juin 2011, le prêcheur évangéliste semble vouloir faire amende honorable. « J’ai tout sacrifié à la Révolution, avec sincérité. J’étais plutôt fier à cette époque. Aujourd’hui, avec le recul, cela me fait frémir et le fait que j’ai tué plus de douze mille personnes est une honte ». Hier, il extorquait des aveux par la torture, à présent il avoue… Si au moment de la chute du régime il avait brulé les archives de S-21 aurait-il ainsi parlé ? Dans un ouvrage récent et saisissant, Thierry Cruvellier[3] scrute ce procès unique : « Douch est le premier accusé qui plaide coupable, reconnaît ses crimes, réfléchit et parle ». Le 26 juillet 2010, condamné à trente ans d’emprisonnement, il conteste aussitôt sa peine. Le mystère demeure au cœur d’un imbroglio politico-éthico-religieux.
Benoît Guillou
Membre de Justice et Paix
Rédacteur en chef de la Chronique d’Amnesty International
[1] Gitta Sereny, Au fond des ténèbres, Paris, Denoël, 2007.
[2] International Justice tribune, « La facture sociale des aveux », Lettre d’information, 8 mai 2006.
[3] Thierry Cruvellier, Le maître des aveux, Paris, Gallimard, 2011.

 CC 2.0 Faustino Garcia
CC 2.0 Faustino Garcia Image par Gerd Altmann de Pixabay
Image par Gerd Altmann de Pixabay 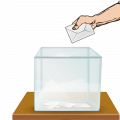 Image par Tumisu de Pixabay
Image par Tumisu de Pixabay 