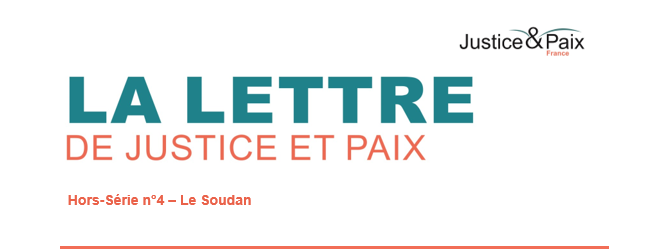II – Comprendre cette guerre
Mars 2025
Pratiquement toutes les guerres se terminent non pas par une « victoire » militaire, mais par des négociations. Les rares guerres où l’une ou l’autre des parties peut revendiquer la « victoire » ne débouchent généralement que sur une « paix » éphémère et superficielle, avant que le conflit ne reprenne de plus belle. La violence engendre la violence, et même les mouvements de libération authentiques qui atteignent leur objectif par la lutte armée sont entachés par des années de violence et de militarisme et se trouvent dans l’impossibilité de gouverner de manière pacifique, juste, démocratique et respectueuse des droits de l’homme. Le Soudan du Sud, voisin du Soudan, est un exemple tragique de cette dynamique.
Toutefois, au Soudan, aucune des parties ne semble prête à entamer des négociations sérieuses. Comme le note l’International Crisis Group (ICG), « laissées à elles-mêmes, les deux parties semblent susceptibles de continuer à se tirer dessus. Toutes deux ont reçu de grandes quantités d’armements étrangers, mais aucune n’a été en mesure de porter un coup d’arrêt. La situation s’est modifiée à plusieurs reprises ». Tous deux continuent de croire qu’ils peuvent remporter une « victoire » militaire. Pendant ce temps, le tissu même de la nation est en train de se déchirer.
Qui détient le pouvoir ?
Cette guerre est souvent décrite comme une lutte de pouvoir entre deux généraux ou deux factions militaires, ce qui n’est pas faux, mais ne donne qu’une image superficielle et incomplète de la situation.
Aucune des parties ne peut prétendre se battre au nom d’un groupe civil, régional, ethnique, politique ou religieux, mais l’armée, créée en 1925, trente ans avant que le Soudan n’existe en tant qu’État indépendant, s’est fermement ancrée dans la vie politique et économique de la nation, non seulement par de longues périodes de dictature militaire à partir de 1958, deux ans seulement après l’indépendance du Soudan, mais aussi par une longue histoire de contrôle de l’économie par l’État (et donc par l’armée).
Plusieurs acteurs internationaux alimentent la guerre en fournissant des armes en échange de l’or et d’autres ressources du Soudan. Mohamed Hamdan Dagalo (« Hemedti »), le chef des RSF (force de soutien rapide, milice paramilitaire) a particulièrement bénéficié de liens avec l’étranger, à la fois en fournissant des mercenaires pour lutter contre les Houthis au Yémen et en acheminant l’or extrait dans les régions qu’il contrôle vers la Russie par l’intermédiaire du groupe Wagner. RSF a déjà été financée par l’Union européenne, soi-disant pour empêcher les migrants de se diriger vers l’Europe, et aurait également reçu un soutien matériel. Plus récemment, elle a reçu un soutien important des Émirats arabes unis et du chef de la milice libyenne Khalifa Haftar, ainsi que de l’Éthiopie et du Tchad. L’Égypte, l’Iran, le Qatar, l’Érythrée et la Turquie soutiennent largement les SAF (Forces Armées Soudanaises), bien que la Turquie se présente également comme un médiateur potentiel. Un certain nombre de groupes régionaux et ethniques du Soudan se sont alliés à l’une ou l’autre partie. En outre, de nombreux combattants des RSF ne sont pas du tout soudanais, mais sont des mercenaires provenant de la ceinture du Sahel, et même des dissidents du Soudan du Sud.
Les RSF sont une évolution de la milice janjawiid encouragée par l’ancien dictateur militaire Omar Hassan al-Bashir à ravager le sud du Soudan et le Darfour dans une longue série de pillages, de meurtres, de viols et de nettoyage ethnique au cours d’une guerre civile antérieure. Ne faisant pas entièrement confiance à sa propre armée, Omar Hassan al-Bashir a officiellement incorporé les Janjawiid en tant que force militaire officielle pour faire contrepoids à l’armée. Pendant cette période, Dagalo et l’actuel chef militaire Abdel Fattah al-Burhan ont été de proches alliés en supervisant les mercenaires conjoints des RSF et des SAF envoyés au Yémen, et c’est Burhan qui a permis aux RSF d’être basées dans des endroits stratégiques à Khartoum. À la suite de l’intifada (soulèvement populaire) non violente qui a débuté en 2018 et s’est achevée par le renversement de Bachir l’année suivante, les RSF se sont alliées aux SAF et un gouvernement de transition dirigé par des civils mais dominé par les militaires a été formé. Les SAF et les RSF ont à nouveau coopéré en 2021 pour renverser ce gouvernement, car ils craignaient tous deux la perspective d’un gouvernement démilitarisé et la perte subséquente de leur propre pouvoir et de leur richesse, Dagalo probablement plus que les SAF. Mais en 2023, les divisions entre les deux groupes, y compris une proposition visant à dissoudre les RSF et à incorporer ses membres dans le SAF, se sont aggravées et ont conduit à une guerre totale.
« Faites la paix et perdez votre emploi »
La plupart des gens, et notamment les Soudanais eux-mêmes, seraient d’accord pour dire qu’une solution durable aux conflits du Soudan exige que les militaires soient complètement écartés de la participation au gouvernement. Toutefois, étant donné que les deux factions militaires s’affrontent précisément pour éviter que l’une ou l’autre ne perde du pouvoir, de l’influence et de la richesse, cette option n’est pas très attrayante pour l’une ou l’autre d’entre elles. Faites la paix et vous perdrez votre emploi (et vous serez probablement traduit devant un tribunal pour crimes de guerre) ! L’International Crisis Group (ICG) résume la situation de la manière suivante : « L’armée s’est retirée de toute piste de négociation, tout en s’engageant publiquement à ne pas négocier avec les RSF. Les RSF ont déclaré qu’elles étaient prêtes à participer à des pourparlers. Mais certaines de ses demandes, notamment celles relatives à l’avenir de l’armée et au statut d’Hemedti dans un gouvernement d’après-guerre, sont probablement irréalisables.
L’armée s’est montrée réticente à conclure un accord pour trois raisons principales. Premièrement, l’armée et ses partisans veulent renforcer leur position militaire avant de s’engager sérieusement avec les RSF. Deuxièmement, l’armée s’oppose fermement à tout format de médiation qui semble la mettre sur un pied d’égalité avec les RSF… Troisièmement, l’armée s’est opposée à la présence de représentants des Émirats arabes unis lors des pourparlers. L’intransigeance de l’armée s’explique également par la faible emprise de Burhan sur une coalition divisée en temps de guerre, qui ne parvient pas à s’entendre sur la voie à suivre »-1
Toute négociation est également compliquée par le nombre de factions qui ont rejoint l’un ou l’autre camp et qui ont également leurs propres exigences, ce qui présente un risque réel de division de facto du pays avec différentes zones sous l’autorité de différentes factions militaires. Les RSF sont généralement plus fortes à l’ouest et les SAF à l’est. Khartoum a d’abord été envahie par les RSF, en grande partie en raison de leur présence dans de nombreux endroits clés, mais ces derniers mois, les SAF ont lentement reconquis certaines parties de la capitale. Mais à l’est comme à l’ouest, il existe des milices ethniques et régionales qui pourraient aspirer à gouverner leurs propres zones, comme cela s’est produit en Libye. Le SPLM-Nord cherche également à étendre son contrôle sur les monts Nouba du Kordofan méridional. En outre, « les membres des groupes qui participent à la guerre mais qui ne font pas partie de l’armée ou des forces de sécurité doivent également s’assurer qu’ils ont un avenir politique. Les plus importants d’entre eux sont les anciens dirigeants islamistes du NCP [National Congress Party], dont un nombre significatif de membres de l’armée, des agences de renseignement et de la fonction publique, qui ont utilisé le conflit pour réaffirmer leur position »-2
Ainsi, le mieux que l’on puisse espérer est probablement un cessez-le-feu avec une sorte d’autorité de transition qui inclura nécessairement des représentants des parties belligérantes, avec pour mission de conduire la nation vers une solution plus permanente. Mais cela ne semble pas très prometteur, car outre le refus des belligérants de négocier sérieusement, cela risque de n’être qu’une répétition de ce qui s’est passé en 2019, après qu’une autorité de transition dirigée par des civils a été mise en place, mais a été contrecarrée à chaque instant par ses membres militaires, et a finalement été renversée par le nouveau
coup d’État qui a été suivi par la guerre actuelle.
Où sont les civils ?
Outre qu’ils sont tués, violés, pillés, terrorisés, dépossédés et déplacés ? En premier lieu, il y a les salles d’intervention d’urgence (ERR). En l’absence de tout gouvernement efficace et avec très peu d’aide humanitaire internationale, des groupes de volontaires locaux ont fourni et coordonné la distribution de nourriture, d’eau et d’aide médicale, des échanges d’informations, de l’éducation, des abris, de la sécurité et d’autres besoins de base. « Le Soudan a une longue tradition de soutien et de générosité entre voisins, mais le sentiment de solidarité au sein des communautés a été renforcé lors du mouvement de protestation qui a débuté en 2018 ». Cependant, la communauté internationale a eu du mal à s’engager efficacement auprès des ERR. Une grande partie de l’aide internationale et de la diplomatie est axée sur des entités reconnaissables dotées de constitutions, d’énoncés de mission, de systèmes administratifs et financiers, de fonctionnaires nommés, d’une responsabilité internationale, d’une transparence, etc. Cependant, la force (et même la survie dans une zone de guerre hostile) des ERR dépend précisément du contraire – localisées, décentralisées, informelles, profondément ancrées dans la culture locale, sans dirigeants facilement identifiables, secrètes, responsables devant la population locale, souvent temporaires et éphémères, une approche localisée qui « peut-être mieux adaptée à la culture et au contexte et plus efficace que les grandes opérations internationales ». Si les négociations de paix portent un jour leurs fruits, si les civils des partis politiques nationaux plus formels et les organisations de la société civile prennent un jour le devant de la scène, les héros et héroïnes des ERR ne doivent pas être exclus ; leurs voix doivent être entendues. « Voir des individus et des groupes soudanais prendre en charge leur propre destin par le biais d’approches locales et communautaires réaffirme le pouvoir de l’autodétermination… Cette approche fait plus que répondre aux besoins immédiats – elle aide à cultiver une génération de jeunes et de volontaires qui s’engagent activement dans la résolution de problèmes, la coordination et la fourniture de services ». Leur engagement actif doit être respecté, utilisé, garanti et sauvegardé au-delà des limites des salles d’urgence.
Au niveau politique national, une coalition d’acteurs civils a été formée en octobre 2023, la Sudanese Coordination of Civil Democratic Forces (Taqaddum, تقدم(, dirigée par l’ancien Premier ministre Abdallah Hamdok. Le 31 octobre 2024, Hamdok s’est exprimé à Chatham House à Londres et a présenté ses propres priorités. Il a parlé du modèle historique qui a forcé le Soudan à « s’intégrer dans la chaîne de valeur mondiale mais à l’extrémité inférieure de celle-ci en tant que producteur et exportateur de matières premières », de la « marginalisation liée à la dynamique centre-périphérie » et de « l’incapacité du Soudan à gérer la diversité » dans « un pays très diversifié, probablement avec plus de 500 groupes ethniques et des différences linguistiques », une diversité qui « n’est jamais une mauvaise chose. Bien gérée, elle devrait être une source de force ». Il note que la politique du Soudan a été dominée par les guerres et les gouvernements militaires, l’effondrement de l’économie rurale et les dimensions géopolitiques du conflit actuel. Il mentionne en particulier « la fragmentation au sein de la communauté régionale et internationale et la manière de gérer les risques liés à la dynamique de la concurrence et des intérêts divergents », mais aussi la fragmentation à l’intérieur du Soudan parmi les civils.
Dans ce contexte de fragmentation, « nous avons pu travailler sur le Tagadom [Taqaddum]. Tagadom est issu de cet environnement » et “comprend cinq blocs : les partis politiques, la société civile, les syndicats et les professionnels, les comités de résistance et certains groupes armés”. Leur proposition, « une perspective civile pour mettre fin à la guerre », repose sur deux piliers principaux. « Premièrement, nous croyons fermement qu’il n’y a pas de solution militaire à ce conflit. Nous ne pouvons le résoudre que par le biais d’un processus politique et d’un dialogue. Nous appelons également à un processus de paix unifié comportant plusieurs volets simultanés. Les conflits actuels ne peuvent pas tous être gérés en un seul endroit, mais nous voulons un centre unifié et d’autres qui peuvent s’y intégrer. L’objectif principal est d’arrêter et de mettre fin à la guerre. Bien entendu, il s’agit de deux processus différents.
Arrêter la guerre, c’est s’occuper des questions de cessez-le-feu et de tout le reste, mais mettre fin à la guerre, c’est là que l’on a besoin d’un processus politique pour s’attaquer aux causes profondes du conflit. Le deuxième objectif est de rétablir la transition démocratique ».
Des principes clés pour la paix
Tout cela repose sur un certain nombre de principes clés : s’attaquer aux causes profondes de la crise ; préserver et soutenir l’unité du pays ; la nécessité d’une armée nationale unifiée qui reflète la diversité du pays et n’est pas impliquée dans les activités politiques et économiques ; la paix durable et la transformation démocratique doivent être liées aux aspirations de la révolution de décembre 2018 et aux objectifs de liberté, de paix et de justice ; l’égalité des citoyens ; la question de la religion et de l’État ; et la justice et la justice transitionnelle. Les trois priorités sont la résolution de la crise humanitaire et la protection des civils, y compris les réfugiés ; un processus de cessez-le-feu pour mettre fin aux combats ; et un processus de dialogue politique pour mettre fin à la guerre, en veillant à ce que les Soudanais s’approprient le processus. « On ne peut pas s’attendre à ce que nous nous appropriions un processus si nous n’en faisons pas partie. Le processus le mieux conçu ne verra pas le jour s’il n’est pas participatif et si les gens ne sont pas consultés à son sujet. Il doit être inclusif, créer un large front contre la guerre et mettre l’accent sur le rôle des groupes communautaires de base, en particulier la société civile, les chefs tribaux et religieux, les groupes de femmes, les jeunes, etc. Taqaddum a proposé un mécanisme pour y parvenir, à savoir une table ronde ou un dialogue soudano-soudanais. On peut lui donner n’importe quel nom, mais il s’agit d’une proposition visant à réunir le front le plus large possible pour aborder les problèmes. Les deux points essentiels sur lesquels nous devons nous mettre d’accord sont que nous voulons mettre fin à la guerre et rétablir la transition démocratique dans un environnement où nous avons maintenant deux camps – ceux qui appellent à la paix et à la fin de la guerre et les bellicistes qui appellent à la poursuite de la guerre et de la destruction. Les choix sont très clairs ».
On aurait pu espérer que ces désaccords ne conduisent pas à une plus grande division, un problème qui a souvent affligé le Soudan, mais en fait Taqaddum s’est effectivement divisé le 10 février 2025 sur la question de savoir s’il fallait participer à un nouveau gouvernement parallèle mis en place par les RSF (forces de soutien rapide). Les membres qui occupent des postes politiques dans l’administration parallèle des RSF sont désormais connus sous le nom de Taasis (Fondation). Il s’agit pour la plupart de mouvements armés, « qui ont parié sur le fait que leurs armes leur permettraient de jouer un rôle de premier plan dans le nouveau gouvernement des RSF ». Les groupes armés n’ont pas d’électorat, ils comptent donc sur un grand acteur armé [comme les RSF] comme garant d’une mer politique… Les leaders politiques traditionnels, y compris Hamdok, qui ont choisi de ne pas rejoindre les RSF ont formé une coalition anti-guerre plus petite appelée Somoud (Résilience), essayant de préserver leur neutralité et leur réputation… Les partis politiques n’ont pas besoin [d’un garant] et ce serait un suicide politique pour eux de former un gouvernement avec les RSF… ils ne veulent pas être perçus comme formant un gouvernement avec des génocidaires » -3. L’archevêque catholique de Khartoum, Mgr Michael Didi Mangoria, a mis en garde contre la formation d’un gouvernement parallèle. -4
La défense de la paix au-delà des alliances partisanes
De nombreux autres groupes plaident pour la paix au Soudan et soulèvent des questions importantes, notamment le démantèlement des dynamiques enracinées qui alimentent le conflit, la nécessité de traiter les récits de guerre violents, les discours de haine et la mobilisation tribale qui ont le potentiel de « s’enliser dans une violence de masse rappelant le génocide rwandais » , la priorité à l’État de droit, la sauvegarde des biens et infrastructures nationaux vitaux, un problème qui est également devenu aigu pour la population de Gaza et de l’Ukraine, et la mise en œuvre d’un nouveau projet national inclusif. Comme lors de l’Intifada 2018-2019, les femmes et les jeunes sont une fois de plus très actifs à tous les niveaux du plaidoyer et de l’action non violente.
Il semblerait donc qu’il y ait plus d’accord sur l’avenir à long terme que sur les moyens d’y parvenir et sur la personne qui doit coordonner le processus. Puis-je terminer en notant quelques points communs qui me sautent aux yeux ? Répondre aux besoins humanitaires urgents des Soudanais, y compris des réfugiés ; arrêter la guerre ; la nécessité d’un dialogue non violent ; un processus inclusif appartenant aux Soudanais et incluant toutes les factions et voix, pas seulement les politiciens « professionnels », pour aborder les causes profondes du conflit et l’avenir du pays ; le retrait des militaires de la politique et du gouvernement ; l’unité du Soudan ; une certaine forme de justice transitionnelle ; la réconciliation et la guérison. Mais rien de tout cela ne peut vraiment démarrer tant qu’il n’y a pas de cessation des hostilités. Les acteurs internationaux portent une lourde responsabilité. Ils alimentent le conflit et en tirent profit, mais, ironiquement, cela leur donne potentiellement une certaine influence sur les belligérants. Puissent-ils l’utiliser à bon escient – et de toute urgence – pour inciter les parties belligérantes à cesser les hostilités et à engager des négociations de paix sérieuses.
* John Ashworth est un missionnaire catholique à la retraite qui a passé plus de quarante ans à travailler avec les Églises du Soudan et du Soudan du Sud, au cours desquels il a activement soutenu la nonviolence, la construction de la paix et la réconciliation dans ces deux pays.
1- ICG, op cit
2- Deeply inspiring and humbling’: neighbourhoods in Sudan are coming together, The New Humanitarian, 31 December 2024,
https://www.theguardian.com/global-development/2024/dec/31/neighbourhoods-sudan-gaps-foreign-aid-community-itchenemergency-response-rooms
3- After splinter, can Sudan’s anti-war coalition reinvent itself? Al Jazeera,
https://www.aljazeera.com/news/2025/2/20/aftersplinter-can-sudans-anti-war-coalition-reinvent-itself
4- “Two Gov’t May Complicate Than Solving Problem,” Says Archbishop of Khartoum, AMECEA,
https://communications.amecea.org/index.php/2025/02/22/sudan-two-govt-may-complicate-than-solving-problem-saysarchbishop-of-khartoum
.