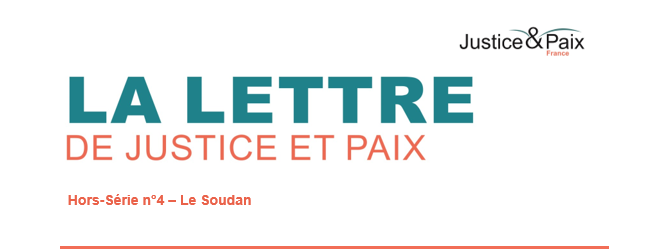IV – Résister et agir
1-Espaces d’Urgence – emergency rooms
Sources : https://sudantribune.com/article301018/#google_vignette et https://www.thenewhumanitarian.org/newsfeature/
2025/04/30/sudan-army-gains-drive-mass-returns-mutual-aid-groups-begin-rebuild
Créées par des bénévoles dès le premier jour suivant le début du conflit, le 15 avril 2023, ces Espaces d’Urgence ont fourni de la nourriture à des millions de Soudanais malgré les pénuries de financement, les obstacles et les violations dont leurs membres ont été victimes, y compris, selon eux, des assassinats. Ils gèrent plus de 800 soupes populaires dans l’État de Khartoum, ainsi que des services de santé, d’approvisionnement en eau et de soutien psychosocial, indépendamment de toute orientation politique ou de tout objectif extérieur.
Ils bénéficient d’un soutien international important pour fournir de la nourriture et des services de santé aux groupes vulnérables dans les zones de conflit et pour documenter les violations. Mais la situation a considérablement changé depuis la réduction du financement américain.
Les retours volontaires – « returnees »
Une nouvelle dimension s’est récemment ajoutée aux problèmes : les personnes déplacées internes ou réfugiées qui rentrent chez elles. Le coût de la vie dans les zones où elles cherchaient refuge est inabordable. L’Organisation internationale pour les migrations a signalé que quelque 400 000 personnes sont rentrées entre décembre 2024 et mars 2025, ce qui a entraîné une baisse du nombre total de déplacements pour la première fois depuis le début de la guerre. Le nombre de rapatriés augmente considérablement, au point d’entraîner une surpopulation et une congestion importantes aux points de passage. « Nous sommes restés bloqués là-bas pendant trois jours sans nourriture, une répétition tragique de notre déplacement initial. »
De plus, le « chez soi » d’antan n’existe plus. La plupart des maisons sont dévastées, la vie communautaire s’est effondrée et des membres de la famille sont morts ou réfugiés dans des contrées lointaines. Nombre de jeunes se concentrent sur les armes et les combats au lieu de songer au retour à l’école. Le tissu social des communautés est « en pleine transformation. Les gens ne comptent plus sur l’armée, et la peur est omniprésente. Les jeunes hommes s’arment par désespoir. »
« C’est la plus grande tragédie à laquelle nous sommes confrontés en tant que rapatriés : nous avons tout perdu, même notre mode de vie. »
La faim représente la plus grande menace pour ceux qui rentrent, en particulier les jeunes enfants, a déclaré un étudiant en médecine et bénévole aux Espaces d’Urgence récemment rentré à Al-Jazirah. « Depuis le début de la guerre, on voit souvent des gens faire la queue pour acheter de la nourriture dans toutes les rues, mais la situation s’est aggravée avec les retours », a déclaré Tagwa. « Le nombre de cuisines collectives est faible par rapport au nombre de personnes qui ont besoin d’aide. »
En réponse, les services d’urgence intensifient leurs activités : en plus de la collecte de dons pour les repas quotidiens, les cuisines communautaires développent des initiatives de jardinage pour aider la population à cultiver sa propre nourriture.
« Aux Espaces d’Urgence pour femmes, nous nous efforçons de collecter le plus grand nombre possible de dons et d’acheter des serviettes hygiéniques en Égypte afin de les distribuer aux familles de retour », a déclaré Rawan, une autre volontaire des Espaces d’Urgence.
Elle ajoute que les efforts de reconstruction nécessiteront de trouver des solutions réalistes pour s’adapter aux conditions. « Pour repartir à zéro, il nous faut réfléchir à des solutions concrètes, comme apprendre à cultiver nos aliments chez nous et recourir à des sources d’énergie alternatives ».
Diffamation
Depuis peu, les Espaces d’Urgence sont confrontés à un autre problème, imprévu : en mai, la coalition fondatrice soudanaise « Tasis » a critiqué la décision du gouvernement de l’État de Khartoum d’interdire toute activité humanitaire non conforme aux procédures légales. La coalition avait affirmé que les Forces paramilitaires de soutien rapide (RSF) auraient protégé les Espaces d’Urgence.
Dans un communiqué, les Espaces d’Urgence de l’État de Khartoum ont déclaré « rejeter ce type de manœuvres politiques mesquines ». « Nous considérons également les allégations de protection par les RSF comme une insulte au carnage subi pendant leur contrôle de Khartoum et aux violations commises par ces forces contre les bénévoles et les citoyens. »
Les Espaces d’Urgence ont souligné qu’ils étaient une organisation indépendante « sans lien avec aucune faction ou alliance militaire et n’appartenant à aucune autre entité que le monde humanitaire ». Ils ont exigé que toutes les parties évitent de les entraîner dans un conflit politique ou militaire. Les Espaces d’Urgence ont également déclaré surveiller les tentatives d’entités politiques et militaires visant à les exploiter par des « déclarations trompeuses » ou en insinuant un soutien ou une affiliation présumés.
2-Options pratiques pour la protection des civils au Soudan
Cet article présente des solutions de protection civile tout à fait faisables. Même si aucune n’a été mise en place jusqu’à aujourd’hui, nous tenons à les présenter pour ainsi souligner que ce ne sont pas les solutions qui manquent mais la volonté politique.
L’entretien a été conduit avec Amgad Fareid El Tayeb, chercheur invité au sein du programme Afrique du Conseil européen des relations internationales. Il a auparavant été chef de cabinet adjoint du Premier ministre (civil) soudanais Abdallah Hamdok et conseiller politique auprès de la Mission politique spéciale des Nations Unies au Soudan (MINUATS). Il a contribué à la dynamique qui a conduit au renversement du régime islamiste d’Omar el-Béchir en avril 2019.
Le Conseil de sécurité de l’ONU a adopté une résolution en juin 2024 demandant au Secrétaire général de proposer de nouvelles mesures pour protéger les civils au Soudan. L’une des suggestions que vous et d’autres avez formulées est la création de zones vertes pour protéger les civils dans les zones de combats actifs. À quoi pourraient ressembler ces zones vertes dans la pratique, selon vous ?
Le niveau de souffrance et d’atrocités subi par les civils au Soudan est actuellement effarant, mais la protection des civils n’a pas été au cœur des efforts de médiation.
La résolution a été adoptée en juin 2024. Il a fallu attendre trois mois avant que le Secrétaire général mène des consultations avec les parties prenantes afin de présenter des options pour la protection des civils après près d’un an et demi de guerre. Cela témoigne du manque d’urgence de la communauté internationale face à la situation au Soudan.
Les zones vertes constituent actuellement l’option la plus réalisable et la plus pratique. L’idée est la suivante : si l’on ne peut pas tout faire, ce n’est pas une excuse pour ne rien faire. Il faut commencer quelque part. Si nous ne pouvons pas protéger tous les civils, délimitons des zones qui puissent offrir un refuge à certains. Ces zones devraient être délimitées de manière à assurer une protection physique, à faciliter l’acheminement de l’aide humanitaire et à offrir une valeur ajoutée économique. Par exemple, certaines zones de l’État de Gezira pourraient reprendre leurs activités agricoles si elles étaient protégées des attaques des SRF et des bombardements des SAF.
Ces zones vertes devraient également inclure des logements, car près de 10,7 millions de Soudanais sont déplacés de chez eux, auxquels s’ajoutent 2,8 millions de personnes vivant hors du Soudan [au moment de l’entretien ; chiffre qui est entre-temps passé à environ 4 millions, ndlr]. Nous devrions également tenir compte de la capacité des infrastructures disponibles dans les zones vertes à fournir des services de base, notamment la communication. L’absence de communications résultant des pannes d’électricité permet que davantage de violations soient commises, car elles sont plus difficiles à signaler. Les communications devraient être maintenues dans les zones vertes.
Par exemple, une zone verte pourrait être délimitée à El-Obeid, capitale de l’État du Kordofan du Nord. El-Obeid dispose d’un aéroport relativement grand, capable d’accueillir de gros avions. Un périmètre de cinq kilomètres de diamètre autour de cet aéroport pourrait inclure le marché de la ville, près de 100 000 logements pouvant accueillir jusqu’à 500 000 personnes, ainsi que l’accès à la région et au reste du pays.
Cependant, ces zones vertes doivent être soutenues par une mission civile internationale dotée d’une forte composante policière pour garantir l’ordre public et soutenir les services sociaux.
Pourriez-vous nous expliquer comment un mécanisme de surveillance conjoint pourrait fonctionner ?
Le mécanisme de surveillance conjoint n’est pas une idée nouvelle. Il a déjà fonctionné lors de la Mission de l’Union Africaine au Soudan (MUAS) au Darfour en 2004. L’idée est que ce mécanisme de surveillance conjoint puisse être soutenu depuis le ciel par un système de surveillance par satellite et depuis la terre par un système communautaire d’alerte précoce capable de signaler conjointement une attaque contre une zone verte. La mission civile internationale peut alors demander à la partie responsable de retirer ses troupes ou, en dernier recours, charger une force militaire défensive de repousser l’attaque. Nous pouvons ensuite étendre le mécanisme de surveillance vers une option plus complète. Nous devons exploiter cette approche, car je pense que de nombreux membres du Conseil de sécurité de l’ONU pourraient être réticents à envoyer des troupes sur le terrain dès maintenant.
Nous devons également mettre en place un autre mécanisme de surveillance conjoint entre les autorités soudanaises et les organisations internationales de défense des droits humains afin de surveiller, signaler et vérifier les violations des droits humains dans les zones contrôlées par le gouvernement. Cela permettra une résolution rapide et efficace de ces violations.
Vous avez déclaré qu’il est nécessaire de redéfinir la protection. Pouvez-vous expliquer ce que vous entendez par là ?
Il faut aller au-delà de la protection physique, car la protection physique par des moyens militaires ne ferait qu’ajouter un troisième acteur militaire à l’équation. Un affrontement entre ces forces militaires serait inévitable, et des accusations de partialité seraient portées.
C’est pourquoi il est important d’avoir une mission qui ne se limite pas à la simple protection physique des civils. L’objectif politique d’une mission potentielle doit être défini comme permettant aux civils de mener une vie relativement normale dans ces zones vertes. Elle doit tenir compte du bien-être, de la dignité et de la sécurité sociale. De nombreuses missions de maintien de la paix classiques ont échoué faute de cette définition élargie de la protection des civils. Cette modalité doit évoluer et nous devons réfléchir de manière créative à la signification de la responsabilité de protéger.
En l’absence de soutien international, les Soudanais ont créé leurs propres mécanismes de protection au niveau local. Comment les populations tentent-elles de se protéger et comment soutenir ces mécanismes locaux existants ?
De nombreuses initiatives locales, notamment les Espaces d’Urgence, les cuisines collectives et les initiatives des chefs religieux, ont fait preuve d’innovation pour répondre aux besoins humanitaires de leurs communautés. Mais elles ne peuvent continuer à agir seules. Elles agissent ainsi parce que personne d’autre ne le fait, faisant preuve de résilience et d’héroïsme courageux et se mettant en danger pour servir leur communauté.
Le monde doit maintenant intervenir et commencer à les aider. On a suffisamment parlé de la protection des civils. Le Secrétaire général de l’ONU mène des consultations sur la protection des civils depuis trois mois. Ces personnes ont oublié leur mandat et se servent du courage des acteurs locaux pour masquer leur incapacité à faire le travail.
Nous ne pouvons pas non plus attendre un cessez-le-feu pour assurer la protection des civils. Un cessez-le-feu est un moyen d’assurer la protection des civils, mais ce n’est pas une condition sine qua non. On ne peut pas demander aux civils de souffrir en attendant un cessez-le-feu.
Auriez-vous autre chose à ajouter ?
Le dialogue sur la protection des civils est malheureusement généralement mené par les acteurs internationaux et régionaux. Il est nécessaire que le Soudan s’approprie le processus. Les parties prenantes soudanaises doivent prendre l’initiative de ces discussions afin de refléter la réalité de ce qui est réaliste et réalisable sur le terrain. En laissant ce débat uniquement sous l’impulsion de l’étranger, certains acteurs peuvent l’utiliser à leur avantage, ce qui pourrait ne pas être conforme aux intérêts du peuple soudanais.
Source : https://theglobalobservatory.org/2024/10/practical-options-for-protecting-civilians-in-sudaninterview-
with-amgad-fareid-eltayeb/ 2 octobre, 2024, IPI Global Observatory, extrait.