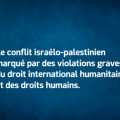« La souffrance est partout et chez tous »
Cet entretien avec Mgr Benoît Bertrand, évêque de Pontoise et vice-président de la Conférence des évêques de France, a été réalisé par Mme Dominique Quinio le 25 août 2025 au retour d’un pèlerinage en Terre Sainte.
Votre déplacement en Terre Sainte, au mois d’août, fut le premier acte du mandat de la nouvelle présidence de la CEF. Pourquoi ce choix ?
Comment marquer le début de cette présidence, autrement que par un écrit, un communiqué, qui ajouterait des mots aux mots ? Un geste fort marquerait davantage les consciences. Nous avons jugé qu’il serait formidable que ce premier geste de notre mandat puisse être d’aller à Jérusalem, l’Église-Mère, tellement éprouvée.
Notre visite, qui se voulait une visite d’amitié, avait trois objectifs. Le premier était de manifester le soutien de l’Église en France à l’égard des communautés chrétiennes de Terre Sainte qui se trouvent dans une grande précarité ; il s’agissait d’une visite des lieux saints, certes, mais surtout d’une rencontre des pierres saintes. Notre deuxième objectif était de manifester notre proximité à tous les amis de la paix, quelles que soient leur religion, leurs convictions. Et enfin, nous voulions prier sur la terre où Jésus a marché, confier notre mandat, offrir notre désir de servir.
Ce fut assez court, quatre jours très intenses ; nous sommes arrivés dans un contexte marqué bien sûr par les horreurs perpétrées le 7 octobre 2023, car le traumatisme en Israël est immense. Et un contexte marqué par la situation extrêmement critique à Gaza, la famine, les 62 000 morts, l’effroi des Palestiniens : « la fosse commune », nous a-t-on dit en parlant de la bande de Gaza. Il y avait eu la visite des deux patriarches, catholique et orthodoxe, qui ont pu aller à Gaza, un mois avant notre venue et cela avait beaucoup marqué les communautés. Enfin, il y a eu les manifestations très importantes, dont nous avons été les témoins (près d’un million de manifestants entre Tel Aviv et l’ensemble du pays), marquant leur désaccord avec la politique menée par le gouvernement.
Nous sommes allés à Taybeh, ce village palestinien en Cisjordanie aux prises avec les exactions de certains colons israéliens, à Bethléem, dans la basilique de la Nativité, vide, tellement vide ; nous avons rencontré les professeurs de l’université catholique qui ont un grand besoin de soutien, de reconnaissance internationale ; des étudiants israéliens artisans de paix ; nous avons pu échanger longuement avec le curé de Gaza par téléphone. Nous avons rencontré le ministre du tourisme de Palestine. Nous avons aussi dialogué avec les responsables du Forum des familles d’otages à Tel Aviv. Et nous avons vu de nombreuses communautés chrétiennes, toutes plus fragiles les unes que les autres. Certaines nous ont dit : « on va bien, mais on ne vit plus ». Ce qui nous a marqués, c’est la souffrance ; elle est partout et chez tous, d’un côté du mur comme de l’autre.
Comment revenez-vous d’un tel voyage ?
Changé, marqué, je dirais presque le cœur brisé, par ce que j’ai vu et entendu. Et encore, nous n’avons pas pu aller à Gaza ; on ira peut-être un jour. L’Autre est perçu comme inquiétant, menaçant, dangereux ; l’Autre, on ne peut plus le rencontrer. Et c’est pour nous une leçon, un enseignement : favoriser autant qu’on puisse le faire les échanges, le dialogue.
Nous revenons en voulant relayer deux appels. Le premier : intéressez-vous à ce qui se vit là-bas, en Israël et à Gaza ; soyez attentifs à l’actualité. Le deuxième : venez. On ne peut plus venir nombreux, mais en petits groupes, c’est possible. Venir, pas seulement sur les lieux, mais voir les personnes, les pierres saintes. Rencontrer les chrétiens, mais aussi des juifs, des Palestiniens.
On a le sentiment que, dans sa parole publique, l’Église qui est en France est assez prudente. Trop prudente ?
Nous avons entendu le cardinal Pizzaballa, le patriarche romain de Jérusalem, nous inciter à la prudence dans le choix des mots. C’est important de bien nommer les choses, mais il est important de ne pas rajouter de la souffrance là où la peur est présente. Si vous critiquez Israël pour ce qu’il fait, cela peut être légitime, en revanche critiquer Israël pour ce qu’il est, ne l’est pas. C’est la ligne de démarcation, très délicate.
Votre pèlerinage n’avait-il pas pourtant une dimension politique ?
Nous sommes venus comme des amis de la paix, pour écouter les uns et les autres. C’était pour nous un devoir de fraternité. La situation paraît, à vue humaine, inextricable. On a pensé à cette parole d’André Louf : « Dieu sait faire des chefs d’œuvre avec les décombres de nos rêves » : c’est ce que nous espérons. Il y avait dans notre pèlerinage une tension spirituelle, avec le mystère d’Israël, le mystère pascal, le mystère de l’Église. Ainsi, Mgr Sabbah, l’ancien patriarche de Jérusalem, nous a-t-il dit : « Sur cette terre, nous continuons à vivre dans notre chair la passion de notre Seigneur ». Il s’agit d’approfondir le mystère pascal pour aider l’Église à accomplir sa mission sur les lignes de fracture du monde d’aujourd’hui. Et la Terre Sainte en est une, malheureusement.