De la COP’21 à Paris en 2015 à la COP’30 à Bélem en 2025
Une paire de souliers noirs, posée sur le bitume. En ce froid jour de décembre 2015, des milliers de personnes ont symboliquement disposé leurs chaussures sur une place parisienne, en soutien à l’avancée des négociations onusiennes. Parmi elles, celles du pape François. De fait, un grand pas allait être franchi, grâce aussi à la poussée citoyenne : l’adoption de l’Accord de Paris, largement célébré comme un ferment d’espoir !
Aujourd’hui, la France se prépare à en marquer le dixième anniversaire et le Brésil à accueillir la COP30 à Belém, du 10 au 21 novembre. Ce serait manier la litote que de dire que la marche des nations pour le climat n’est pas allée au bon rythme. Quels sont ainsi les enjeux de cette COP majeure ? Et quel peut être notre rôle, comme chrétiennes et chrétiens ?
Un fonctionnement clé mis en place par l’Accord de Paris doit être rappelé. Tous les États doivent avoir des objectifs climat, dits « contributions déterminées au niveau national », qui sont révisées tous les 5 ans. Cette revue est informée par un « bilan mondial », qui a lieu 2 ans auparavant. L’idée est qu’une dynamique vive de 5 ans en 5 ans, avec des ambitions à chaque fois relevées et des actions renforcées, par émulation entre États.
2025 est justement année de renouvellement. Or le bilan mondial, dressé en 2023, tout comme quantité d’expertises, ont démontré l’insuffisance à la fois des buts affichés et des politiques menées. Sans sursaut vers la COP30, l’Accord de Paris est menacé de mort, et avec lui des millions de vies humaines et non humaines qui ont une valeur inestimable devant Dieu.
Sur la trajectoire actuelle d’émissions de gaz à effet de serre, le monde se dirige vers un réchauffement de 3,1°C. Une planète étuve. L’objectif de contenir le réchauffement sous les 1,5°C repose déjà, lui, au cimetière des conflits d’intérêts. Et pour avoir une chance de rester sous les 2,0°C – chaque dixième de degré compte, alerte la science – les émissions mondiales doivent baisser de 4 % par an. En 2024, elles ont augmenté… et même établi un record.
Le défi premier consiste à organiser la sortie rapide et juste des énergies fossiles. Cette vision, acquis clé de la COP28, est en danger. Des initiatives comme le Traité de Non-Prolifération des Combustibles Fossiles[1] s’emploient à en défendre la réaffirmation à la COP30. L’enjeu est d’autant plus crucial que 425 « bombes carbone »[2] sont en projet dans le monde, soutenues par les grandes banques qui ont injecté 7 900 milliards de dollars dans le secteur fossile depuis la COP21[3], tandis que les solutions alternatives existent.
Dans le même élan, il faut lutter contre la déforestation, pour éviter les émissions liées et protéger les puits de carbone des écosystèmes forestiers, avant tout tropicaux. Ce chantier sera sous les projecteurs au Brésil, qui a choisi de tenir la COP en Amazonie.
Guidés par le souci des plus vulnérables, des pauvres aux femmes et aux peuples autochtones qui sont au cœur d’une écologie intégrale, l’adaptation et la résilience doivent cesser d’être seconds et la prise en charge effective des pertes et les dommages serait justice. L’argent étant un nerf de la guerre, la question des financements climat et des dettes des pays du Sud reste vitale. Elle pâtit de blocages indignes au regard d’un monde qui n’a jamais été aussi riche – le produit mondial brut a dépassé les 110 000 milliards de dollars selon la Banque mondiale –, et de la dette écologique des pays du Nord qui change le regard et mène à voir financements et remises de dettes comme des remboursements, et non des gestes de charité.
Il est certes impossible d’augmenter l’ambition si l’enjeu n’est pas reconnu. Autour du globe, l’élection de climato-négationnistes, la montée des extrêmes droites, mais aussi les reculs assumés par des gouvernements de centre, mettent en danger la reconnaissance des faits ou de leur importance. Dans la lignée de Laudate Deum, Léon XIV a rappelé sans détour que la question climatique n’est ni une tendance passagère ni une connaissance dont on peut douter.
Il est tout aussi impossible de porter une transition juste sans les personnes premières concernées. Pourtant depuis des années, le nombre d’accréditations données par l’ONU à la société civile – y compris religieuse – baisse, quand la place des lobbies fossiles croît. Et la COP à Belém risque d’être la moins inclusive de l’histoire : il n’y a pas assez d’hébergements et les prix sont exorbitants, privant beaucoup d’acteurs modestes de participer.
Que pouvons-nous faire ici ? À la conférence Susciter l’espérance célébrant les 10 ans de Laudato si’, Léon XIV rappelait la responsabilité partagée de « faire pression sur les gouvernements » et de « jouer un rôle actif dans la prise de décisions politiques »[4]. Plusieurs initiatives vers la COP offrent de s’engager, depuis les veillées de prière pour confier ce rendez-vous et inspirer sagesse et courage aux participants[5] jusqu’aux cercles de silence dans l’espace public pour interpeler les consciences et appeler à l’action ambitieuse[6].
Par-delà la COP, le temps est à l’approfondissement de notre conversion écologique. Cela se joue dans nos cœurs, centre de l’élan et de la vérité de chaque personne. Cela s’exprime par nos mains, avec lesquelles nous pouvons œuvrer à un changement de paradigme. Car l’enjeu est bien intégral, du retournement de l’être vers un changement sociétal. Afin que toutes, oui toutes les créatures, puissent vivre des vies épanouies !

[1] Voir : https://fossilfueltreaty.org/
[2] Voir : « Projects » en anglais, www.carbonbombs.org
[3] Voir : « Report » en anglais, www.bankingonclimatechaos.org
[4] Lire son discours ici : www.humandevelopment.va
[5] Bibliographie : v. sur le site de la CEF (www.eglise.catholique.fr) Temps pour la création
[6] Consulter l’appel : www.lutte-et-contemplation.org/cop30-cercles-silence-appel

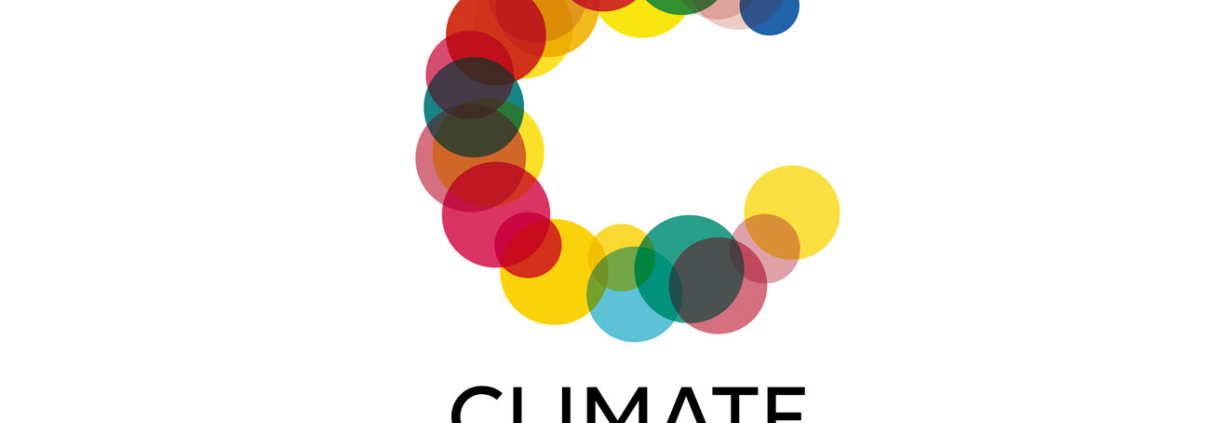 @ https://www.climate-chance.org/
@ https://www.climate-chance.org/
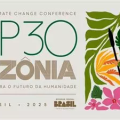
 Image par annca de Pixabay
Image par annca de Pixabay  © Ministry of Environment of Colombia - https://commons.wikimedia.org/
© Ministry of Environment of Colombia - https://commons.wikimedia.org/