Elections américaines
L’élection de Donald Trump pour un deuxième mandat après celui de 2017-2021 est un choc. Pour beaucoup il est difficilement compréhensible qu’un homme qui a refusé de reconnaître sa défaite lors de la précédente élection et qui est sous le coup de plusieurs actions en justice pour tentative de renversement des résultats puisse être élu dans la première puissance mondiale (aux plans économique, militaire, géopolitique) au fonctionnement démocratique éprouvé depuis près de 250 ans. C’est un choc mais pas totalement une surprise pour qui suit la politique américaine. Les sondages, qui sont un exercice périlleux compte tenu de la complexité du système électoral, ont toujours donné une élection serrée avec des chiffres compris dans la marge d’erreur. Quelles premières leçons en tirer ? À la lumière de l’enseignement social de l’Église, je propose quelques remarques sur le défi que pose, selon les mots du pape François, la « maladie dangereuse » [1] dont souffrent nos démocraties et dont l’élection américaine montre bien des signes. Le défi de la démocratie mise en péril par le populisme se nourrissant de la fragmentation de la société et nécessitant de relever le défi de l’information à l’heure de la révolution numérique.
Mais d’abord les faits. L’élection s’est déroulée dans le calme et son résultat est sans appel. Donald Trump est arrivé en tête pour le collège des grands électeurs (312 contre 226). Il a remporté les sept « États pivots » dont les six que Joe Biden avait gagnés en 2020. Les républicains ont la majorité au Sénat et également à la chambre des représentants (même si elle reste très faible). Au contraire de sa première victoire en 2016, il arrive aussi largement en tête pour le vote populaire cumulé à l’échelle du pays avec environ 2,5 millions de votes de plus que Kamala Harris (en 2020 Biden avait obtenu 7 millions de votes de plus que Trump, et en 2016 Hilary Clinton, bien que défaite par le collège électoral, avait obtenu 3 millions de votes de plus que Trump au plan national). Donald Trump progresse en pourcentage et en nombre de votes à peu près partout dans le pays alors que Kamala Harris obtient près de 6 millions de votes de moins que Biden en 2020. Surtout on constate que Trump progresse dans quasiment toutes les catégories de la société y compris celles qu’on pense les plus réfractaires à ce qu’il incarne : les Latino-Américains, les Afro-Américains, mais aussi les jeunes, les femmes, les habitants des grandes villes. Ce qui reste indubitable c’est que le fossé continue à se creuser entre zones rurales et zones urbaines et entre personnes diplômées de l’enseignement supérieur et personnes non diplômées, catégories qui se recouvrent pour une large part. De l’ordre de 60 à 65 % des personnes sans diplôme votent Trump et c’est l’inverse pour les diplômés. 30 ans en arrière, on avait la situation contraire avec les non-diplômés penchant majoritairement du côté démocrate.
Dans le cinquième chapître de Fratelli tutti [2], le pape François décrit ce qu’il envisage comme « une meilleure politique« . « Une meilleure politique, mise au service du vrai bien commun, est nécessaire pour permettre le développement d’une communauté, capable de réaliser la fraternité à partir des peuples et des nations qui vivent l’amitié sociale ». Mais il ajoute : « Au contraire, malheureusement, la politique prend souvent aujourd’hui des formes qui entravent la marche vers un monde différent » (FT 154). Tout en défendant avec vigueur la notion de peuple, le pape argentin décrit avec précision les dangers d’une dérive qu’on pourrait qualifier de populiste (même si en suivant le conseil de François, il est sans doute prudent d’éviter de classer les personnes, les groupes, les sociétés dans une division binaire « populiste » ou « non-populiste » risquant de ne mener qu’à une polarisation stérile[3]). Le pape explique donc : « Il y a des dirigeants populaires capables d’interpréter le sentiment d’un peuple, sa dynamique culturelle et les grandes tendances d’une société ». On ne peut dénier à Donald Trump d’évidentes capacités en ce sens. La connexion qu’il établit avec toute une partie de la population est réelle. Les images de son poing levé dans les instants suivant la tentative d’assassinat dont il a été victime en juillet ont marqué les esprits. Ses outrances révulsent beaucoup de monde mais sont aussi perçues par toute une catégorie d’Américains comme l’expression de « ce que nous pensons tout bas ». Le pape François poursuit : « la fonction que [les dirigeants populaires] exercent, en rassemblant et en dirigeant, peut servir de base pour un projet durable de transformation et de croissance qui implique aussi la capacité d’accorder une place à d’autres en vue du bien commun ». Le pape ajoute cependant : « Mais elle se mue en un populisme malsain lorsqu’elle devient l’habileté d’un individu à captiver afin d’instrumentaliser politiquement la culture du peuple, grâce à quelque symbole idéologique, au service de son projet personnel et son maintien au pouvoir. Parfois, on cherche à gagner en popularité en exacerbant les penchants les plus bas et égoïstes de certains secteurs de la population. Cela peut s’aggraver en devenant, sous des formes grossières ou subtiles, un asservissement des institutions et des lois » (FT 159). On ne saurait mieux décrire ce qui est à l’œuvre avec Trump.
Le lendemain de l’élection, Kamala Harris a appelé Donald Trump pour concéder officiellement sa défaite. Puis elle a fait un discours public dans le même sens. Le président sortant Biden a reçu quelques jours plus tard le président nouvellement élu pour organiser une transition ordonnée du pouvoir (elle aura lieu le 20 janvier 2025). Le contraste est saisissant avec l’élection de 2020. Donald Trump n’a jamais reconnu officiellement sa défaite. Il n’a pas téléphoné au président élu et ne l’a pas reçu à la Maison Blanche. La démocratie est bien plus que le simple processus d’élection conduisant à la désignation des gouvernants et des législateurs. Mais sans un tel processus conduit avec suffisamment de transparence et suscitant un minimum d’adhésion, la démocratie n’est pas possible. Si le perdant ne reconnaît pas sa défaite la confiance est rompue. Aujourd’hui, ¼ des Américains et plus de la moitié de ceux qui se reconnaissent républicains considèrent que Donald Trump était le vainqueur légitime de l’élection 2020. Le coup de téléphone du perdant au gagnant est bien plus qu’un simple geste de politesse.
Dans la logique de son déni des résultats de 2020, Donald Trump envisage de continuer à attaquer les aspects de l’État de droit qui pourraient freiner ses projets. Par exemple, il souhaite passer par-dessus la procédure d’approbation des membres de son gouvernement par le Sénat en détournant à son profit une clause d’exception (si le Sénat est en congé, pour ne pas bloquer une nomination à un poste indispensable pour le bien du pays, le président peut faire une nomination temporaire). Comme il l’a fait lors de son premier mandat, il envisage aussi de continuer à profondément transformer le corps judiciaire par les nominations qui sont de son ressort. Ce qui représente un contre-pouvoir nécessaire le restera-t-il face à un président qui contrôle non seulement l’exécutif et le législatif (avec les deux chambres du Congrès) mais aussi dans une certaine mesure la Cour Suprême (qui a une solide majorité républicaine et trois de ses membres nommés par Trump) ? L’avenir le dira et rien n’est totalement joué; mais il est certain que la démocratie est fragilisée.
Depuis Pie XII et son message de Noël 1944 où il reconnaissait que « la forme démocratique du gouvernement apparaît à beaucoup comme un postulat naturel imposé par la raison elle-même »[4], l’Église catholique a largement embrassé le soutien aux formes démocratiques de gouvernement. François soulignait en juillet dernier que « la démocratie porte en elle une grande valeur indubitable : celle d’être ensemble ». « Ensemble est synonyme de participation » et « c’est précisément dans le verbe « participer » que l’on trouve le sens authentique de la démocratie »[5]. Dans un contexte où elle est de plus en plus fragilisée, il y a sûrement une vraie responsabilité pour les fidèles catholiques de saisir à nouveau son importance et en quoi elle doit être défendue et renforcée au nom de l’Évangile (sans éluder bien sûr ses limites et les nécessaires adaptations ou évolutions qu’elle requiert en fonction des contextes). Un engagement explicite de la part des évêques serait également le bienvenu. On ne peut que s’interroger sur la faiblesse de la parole des évêques américains sur le sujet. Les catholiques américains ont voté majoritairement pour Trump dans des proportions légèrement supérieures (de 4 ou 5 points) à l’ensemble de la population. Il n’est pas vraiment prouvé que la religion joue un rôle fort pour le vote des catholiques; mais précisément, ne devrait-elle pas davantage le faire ? Non pas par le retour à des consignes de vote mais par une formation en profondeur des consciences ?
Mais ce que montre la campagne et l’élection américaine, c’est que le fait de pointer les risques pour la démocratie du projet et des actions d’un candidat n’ait que de peu d’effet sur le vote. Les enquêtes sur les motivations des votes montrent bien que ce sont les questions du quotidien qui ont compté : l’inflation (non pas les chiffres généraux mais le vécu de celles et ceux qui vont au supermarché ou à la pompe à essence), l’immigration perçue comme une menace… Un péril pour la démocratie n’entre pas en ligne de compte pour beaucoup d’électeurs. Et il faut reconnaître que la liberté du vote reste une réalité forte. On constate que des États peuvent avoir élu un gouverneur démocrate en 2023 et voter Trump à près de 65 % (Kentucky), des comtés votent Trump aux présidentielles et démocrate pour leur représentant. Des républicains votent Trump mais s’opposent dans un référendum à une restriction de l’avortement.
On a même vu à quel point le fait pour Kamala Harris de désigner Donald Trump comme « fasciste » dans les derniers jours de campagne a été contreproductif. Non que cela soit faux : des personnes ayant exercé des responsabilités aux côtés de Trump comme John Kelly son ex-chef de cabinet ont eux-mêmes usé de ce qualificatif pour décrire son comportement autoritaire et son approche dictatoriale des affaires publiques. Mais dans un pays où la majorité de la population est peu au fait de l’histoire européenne et de la signification d’un tel vocable, catégoriser ainsi le candidat n’a fait que renforcer le sentiment qu’on les prenait de haut, les considérant tous comme des fascistes comme leur candidat.
Une leçon à tirer de cette élection est que le combat pour la démocratie et contre les méfaits d’un populisme comme celui de Trump passe nécessairement par un travail en profondeur pour retisser les liens dans une société fragmentée et polarisée où toute une partie de la population se sent regardée de haut par les autres (les citadins diplômés, les élites qui détiennent le pouvoir politique, les grands médias traditionnels…). Un chroniqueur dans le New York Times le lendemain de l’élection, engageant une réflexion auto-critique, a choisi le titre : « Message des électeurs aux élites : est-ce que vous me voyez maintenant ? »[6]. L’image n’est pas sans fondement en effet. On voit bien que les discours expliquant combien l’économie va bien (ce qui est vrai au plan macro-économique) sont non-seulement inaudibles pour les personnes qui -au quotidien- ont vu le prix des denrées alimentaires et de l’essence flamber ces quatre dernières années mais combien ils sont aussi condescendants. Tout comme certaines manières de remettre en cause une vision de l’histoire, du genre ou de la sexualité. Beaucoup d’analystes soulignent les conséquences négatives de l’accent mis par le parti démocrate sur les questions « identitaires » et d’émancipation de divers groupes (ethnicité, genre, orientation sexuelle…) au détriment de la prise en compte des questions sociales et économiques de ce qu’on pourrait appeler les classes laborieuses (« working class »). Cela est visible notamment dans le basculement d’une partie des Afro-Américains et surtout des Latinos vers Trump. Ce qui semble certain c’est qu’en profondeur, le mépris de classe offre un terreau de choix pour tout discours populiste. La légitimité des experts et des sachants étant perdue en même temps qu’une confiance dans les institutions, les fausses informations et les théories les plus conspirationnistes peuvent fleurir. Sans doute le plus grand défi pour la société américaine (et aussi nos sociétés européennes ?) est de pouvoir retisser des liens de respect et de confiance entre les différentes composantes de la société et notamment entre celles et ceux qui détiennent un pouvoir politique, économique -ou encore médiatique ou scientifique-, et le reste de la population. L’appel du pape François à la fraternité et à l’amitié sociale est plus que jamais d’actualité. Il passe par une écoute mutuelle en vérité, particulièrement de celles et ceux qui sont les plus pauvres, les exclus, les marginalisés.
Il faut aussi regarder en face l’effet de la révolution numérique, notamment dans le domaine de l’information, sur le processus démocratique. Le rôle d’Elon Musk dans la campagne de Donald Trump est incontestable, non seulement par l’argent (on parle de plus de 130 millions de dollars) mais aussi parce que le propriétaire de X (anciennement Twitter) a largement mis le réseau social au service de la cause qu’il a embrassée. Il se fait le relais sur son propre compte (205 millions de followers) des fausses informations les plus grossières comme celle selon laquelle les supporters de Kamala Harris faisaient entrer illégalement des dizaines de milliers de migrants pour aller bourrer les urnes. Mais surtout, comme l’a montré une enquête du Wall Street Journal, loin de sa neutralité affichée, X promeut de manière biaisée des contenus politiques grâce à ses algorithmes. L’enjeu de l’information est une clé pour la démocratie. Le passage des médias traditionnels aux réseaux sociaux qui deviennent la principale source d’information pour les plus jeunes générations notamment par le biais des influenceurs, pose au moins deux défis majeurs, que cette élection a rendus encore plus visibles. Le défi de la lutte contre les fausses informations et la désinformation -qui ont atteint des sommets inégalés- et le défi de la constitution de bulles d’informations de plus en plus hermétiques. S’il est manifeste que les téléspectateurs de Fox News ne regarderont quasiment jamais NBC et réciproquement, la fracture est encore plus grande et hermétique pour les podcasts et autres chaînes YouTube où l’on voit fleurir des influenceurs de plus en plus populaires mais de plus en plus éloignés d’un professionnalisme journalistique.
Là encore l’analyse du pape François touche particulièrement juste : « On ne peut pas ignorer que de gigantesques intérêts économiques opèrent dans le monde numérique. Ils sont capables de mettre en place des formes de contrôle aussi subtiles qu’envahissantes, créant des mécanismes de manipulation des consciences et des processus démocratiques. Le fonctionnement de nombreuses plates-formes finit toujours par favoriser la rencontre entre les personnes qui pensent d’une même façon, empêchant de faire se confronter les différences. Ces circuits fermés facilitent la diffusion de fausses informations et de fausses nouvelles, fomentant les préjugés et la haine »[7].
Même si le plus prévisible chez Donald Trump est son imprévisibilité, on peut -sans risquer de se tromper- prédire que son nouveau mandat est porteur de lourds nuages, au minimum en ce qui concerne une politique migratoire respectueuse de la dignité des personnes, un engagement pour une véritable conversion écologique, ou encore un travail multilatéral international pour construire une paix durable. Autant de domaines où l’enseignement social de l’Église offre une solide orientation. Les enseignements de son élection sont d’autant plus importants à tirer pour éviter que nos pays européens ne suivent le même chemin (sur lequel ils sont sans doute déjà engagés).
[1] François, « Introduction » dans Al cuore della democrazia. Juillet 2024. https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2024-07/francois-la-democratie-c-est-resoudre-ensemble-les-problemes.html
[2] François, Fratelli tutti (2020). www.vatican.va
[3] Cf. FT 156
[4] Pie XII, Radio-Message de Noël (1944). www.vatican.va
[5] François, Al cuore della democrazia
[6] https://www.nytimes.com/2024/11/06/opinion/trump-elites-working-class.html
[7] François, Fratelli tutti (2020), 45.

 © AP - Evan Vucci (Cf. Wikipedia)
© AP - Evan Vucci (Cf. Wikipedia)
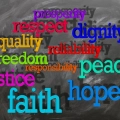 Pixabay
Pixabay
