1- Demeurer des artisans de paix dans un monde en tension
De l’Ukraine à Gaza, du Soudan à la République Démocratique du Congo, du Yémen à la Birmanie, une actualité funeste envahit notre quotidien d’informations tragiques. Notre accablement n’est rien au regard de ceux qui subissent cette fièvre guerrière. Les morts, les blessés et les déplacés s’y comptent en millions, les traumatismes psychologiques s’y accumulent de façon incommensurable et les perspectives d’une vie apaisée paraissent une chimère inaccessible. À moindre bruit, des flambées de nationalismes se saisissent de bien des espaces politiques, rendant possibles d’autres guerres et fracturant toujours plus une planète dont les problématiques appellent urgemment des solutions concertées. La lutte contre le changement climatique, la solidarité Nord-Sud, la régulation des échanges commerciaux, la progression de la santé ne peuvent s’accommoder des rodomontades et des agissements de bien des leaders nationalistes arrivés aujourd’hui au faîte du pouvoir.
Ce balayage rapide d’une scène mondiale embrasée nous inquiète, car le rapport de force et la guerre sont revenus à l’ordre du jour quand, à la fin de la guerre froide, cette dernière semblait pourtant vouée à disparaître. C’est sur ce retour de la guerre et du choix de la force, en dehors de tout cadre légitime, que nous portons notre réflexion ici. Nous le faisons en tant que simples observateurs préoccupés d’un monde dont nous nous sentons comptables. Nous nous le permettons aussi en tant que chrétiennes et chrétiens dont la foi ne s’accommodera jamais de cette violence massive qui défigure encore trop notre humanité. Il n’est d’ailleurs pas étonnant que Léon XIV, à peine élu pape, ait mis la paix au centre de son premier discours.
Comment est-on parvenu à ce moment où l’histoire est de nouveau gagnée par les affrontements à grande échelle ? Quelles sont les causes de ce mauvais emballement ? Comment peut-on encore le prévenir ? Dans ce contexte peut-on être encore un artisan de paix ? En quoi la foi chrétienne apporte-t-elle des éléments substantiels pour le devenir ? C’est à cette tâche que nous nous attelons ici en sachant que l’exercice est ardu…/…
…/…Alors que le ciel était au bleu, des nuages sombres se formaient. Les élections libres en Yougoslavie, les premières depuis des décennies, allaient faire gagner les nationalistes dans toutes les républiques fédérées et ce fut la guerre qui en fut l’issue en Slovénie, en Croatie puis surtout en Bosnie, avant qu’une nouvelle réplique violente ne frappe le Kosovo en 1999. En Afrique, le génocide des Tutsis par les Hutus, qui fit quelque 800 000 morts d’avril à juillet 1994 montrait aussi combien les nuages funestes obscurcissaient l’horizon. Ces deux guerres, celles de Yougoslavie et celle du Rwanda montraient qu’une nouvelle ère d’affrontements se faisait jour. Mais c’étaient moins les idéologies qui les portaient que des identités en concurrence. Pour dire cette prééminence de l’identité dans la nouvelles conflictualité, l’intellectuel camerounais Achille Mbembé parle d’une « ère de viscéralité » pour dire combien ces nouvelles violences nous renvoient aux tréfonds de nous-même, en sachant que ce sont des entrepreneurs identitaires qui attisent ces poussées politiques. Ce basculement de l’idéologique à l’identitaire allait s’accélérer au début du 21e siècle et plus encore après 2010.
Plutôt que de décrire à l’envi ces séquences, nous devons essayer de comprendre ce qui explique ces bascules identitaires, en sachant que les mécanismes à l’œuvre sont complexes autant que divers. Il faut d’abord distinguer les guerres civiles, qui essaiment surtout en Afrique, des poussées nationalistes qui peuvent produire aussi la guerre. Dans le premier cas, c’est généralement l’incapacité des États à être celui de tous, qui conduit des groupes revanchards à défier le régime prédateur. Du Rwanda à la Birmanie, de la Syrie au Soudan, de la Libye au Yémen, de l’Éthiopie à la Somalie, les guerres civiles récentes ou en cours s’expliquent par ce rapport prédation/revanche qui signe l’incapacité à faire vivre un État qui devrait être un toit politique pour tous. Dans ces contextes quand les identités deviennent meurtrières, elles se définissent à l’aune de l’ethnie, du clan ou de la communauté.
Ailleurs, c’est le nationalisme qui devient le mobilisateur identitaire. Mais en l’espèce, derrière le nationalisme se cachent des dynamiques propres à chacun. Distinguons en fait quatre nationalismes, dont les causalités empruntent à des mécanismes variés, même si chacun charrie une tendance à s’enraciner dans un sentiment d’humiliation.
 @ https://wikirouge.net/
@ https://wikirouge.net/
Le nationalisme de libération est celui qui nait au cœur des peuples qui ont subi la loi de domination de certains autres. C’était particulièrement vrai au lendemain de la Seconde Guerre mondiale où les peuples ont exprimé ce nationalisme pour se défaire du joug colonial. Mais alors que ce nationalisme semblait quasiment remisé, il a fait son retour depuis la fin de la guerre froide dans des espaces où des peuples ont continué à subir l’oppression. Des Bosniaques, Croates et Slovènes qui avaient subi la prééminence des Serbes, aux Tchétchènes qui avaient subi le joug de Moscou, en passant par les Arméniens du Haut-Karabakh sous contrôle de l’Azerbaïdjan depuis que Staline avait recomposé les territoires du Caucase, ce sont des nations qui se sont réveillées après le dégel communiste. Au Moyen-Orient, le nationalisme palestinien, longtemps nourri par la dépossession territoriale et le déni politique, s’est de nouveau réveillé après les promesses déçues d’un processus de paix qu’Israël n’a eu de cesse d’entraver.
À ces nationalismes qui participent des nationalismes postcoloniaux s’en sont ajoutés de nouveaux dont les causalités diffèrent, eu égard à des contextes inédits qui se font jour. Le nationalisme d’amputation alimenté par la perte de territoires est celui qui caractérise particulièrement la Russie qui, pendant trois siècles, s’est pensée en vaste empire. En perdant plus de dix France en 1991 puis en voyant l’Otan s’approcher de son espace, ce nationalisme a pris un tour de plus en plus agressif, décuplé par l’arrivée de Vladimir Poutine au pouvoir en 2000. Ce nationalisme est particulièrement guerrier si l’on se réfère aux conflits successifs en Tchétchénie (1994-1996 puis 2001-2002), en Géorgie (2008) puis en Ukraine (depuis 2014).
À rebours de ce nationalisme « perdant », un nationalisme d’émergence s’affirme depuis le début du millénaire. Il est imputable aux pays dont les performances économiques leur donnent non seulement une nouvelle prospérité mais aussi une volonté de peser dans le concert des nations. Grand vainqueur de la mondialisation, en devenant le principal atelier de la planète, la Chine s’inscrit dans ce type nationalisme tout comme l’Inde, la Turquie qui elles aussi ont connu des croissances extrêmement soutenues pendant vingt ans. Ces trois grands pays ont aussi en commun de devenir plus agressifs, tant sur le plan interne que sur le plan externe.
Les démocraties ne font pas exception à cette poussée nationaliste car elles sont soumises aux assauts d’un nationalisme d’essoufflement, celui qui prend racine dans des sociétés qui ont perdu de leur prospérité et de leur influence. Du Make America Great Again (MAGA) clamé ad nauseam par les trumpistes américains aux « Français d’abord » de l’extrême droite hexagonale, c’est un nationalisme de rejet qui fleurit en prenant parfois le pouvoir comme en Hongrie, en Italie, aux Pays-Bas, aux États-Unis ou en s’y tenant à l’affût dans beaucoup de démocraties fatiguées. La relégation sociale et économique de certains secteurs sociaux ou territoriaux, la difficulté de vivre dans des sociétés multiculturelles ainsi que la demande d’autorité, quand ce n’est pas d’autoritarisme, sont parmi les ingrédients de ce nationalisme. Mais les performances électorales de ces courants ne seraient pas si grandes sans les évolutions de l’information. Entre le développement de médias identitaires et l’essor des réseaux sociaux, c’est en effet un contexte informationnel inédit qui catalyse ce nationalisme exclusif. Bien sûr, Internet n’est pas en soi un problème mais comme l’a montré Giovanni Da Empoli, des « ingénieurs du chaos », tels qu’il les nomme, œuvrent à aimanter les utilisateurs vers des idées nauséabondes, à commencer par la Russie qui excelle dans « cette rencontre de la rage et de l’algorithme ». Nul besoin d’en dire davantage ici à ce sujet : nous renvoyons à ce que nous avions écrit dans une de nos précédentes contributions (« Quête de vérité et industrie du mensonge, ainsi va le monde », 29 décembre 2022). Ces nationalismes à fort ressentiment comportent aussi leur potentiel de violence, à commencer par les supposées minorités internes qu’ils ostracisent. Ils ont par ailleurs la particularité d’être marqués du sceau du populisme qui se caractérise par la prétention d’un leader à se vouloir directement branché sur le peuple, et de ce fait à critiquer les contre-pouvoirs, notamment ceux des juges et des médias, avec le risque de réduire à terme la démocratie et de la transformer en démocrature. Victor Orban est une illustration déjà ancienne de ce type de dérive, comme maintenant Donald Trump qui, en quelques mois, s’est attaqué à la plupart des contre-pouvoirs que comptent les États-Unis.
 @ NSassin – https://commons.wikimedia.org
@ NSassin – https://commons.wikimedia.org
Rappelons-le, cette grille n’est qu’une aide à différencier des néonationalismes à l’œuvre en vue de clarifier les différentes causes en jeu. Certains nationalismes demeurent inclassables du fait de leur caractère très spécifique, comme dans le cas d’Israël aujourd’hui soumis à un féroce nationalisme et qui le conduit à user d’un répertoire génocidaire à l’endroit des Palestiniens. Ce nationalisme diasporique, tel que l’avait évoqué l’anthropologue Ernest Gellner, et qui a permis de rassembler les Juifs persécutés en Europe, a basculé dans un nationalisme de plus en plus assoiffé de territoires, déniant aux Palestiniens toute aspiration à la souveraineté.
Ce nationalisme israélien est devenu de plus en plus religieux. Il n’est pas le seul. Car plus généralement tous ces néonationalismes ont en commun de faire la part belle à la dimension religieuse. Tout se passe comme si la religion (religare, qui relie) pouvait constituer un ciment national quand aucune idéologie ne semble plus s’imposer. Qui plus est, la religion peut tendre à sacraliser la nation. Cette hybridation se vérifie dans toutes les aires cultuelles : l’orthodoxie est célébrée par Vladimir Poutine, l’évangélisme et le catholicisme sont instrumentalisés par Victor Orban, Donald Trump et bien d’autres nationaux populistes européens, l’hindouisme se trouve au cœur du nationalisme de Narendra Modi, le bouddhisme est en arrière-plan de celui de la junte birmane, le judaïsme est de plus en plus intriqué au nationalisme israélien, de même que l’islam est en appui du nationalisme de Tayyep Recep Erdogan. Même en Chine, Xi Jinping a réhabilité le confucianisme qui avait pourtant été combattu par le parti communiste chinois.
Cette incandescence nationaliste, ressourcée à la matrice religieuse, n’est pas une bonne nouvelle, tant elle menace le multilatéralisme, qui permet de gérer de façon concertée les affaires du monde, mais également la démocratie dont on croyait qu’elle allait se développer après la guerre froide. Car sous les assauts du national populisme, ce sont les démocraties les plus installées qui sont menacées d’involution. Nous renvoyons à ce sujet à notre contribution du 20 avril 2024, « La démocratie un bien commun à sauvegarder ».
Par-delà ces menaces qu’il fait peser sur le multilatéralisme et la démocratie, c’est le retour du militaire dont le spectre se rapproche toujours plus de ce nationalisme invasif. Celui-ci est bien à la source d’un réarmement généralisé alors qu’à la fin de la guerre froide, on avait constaté une décrue notoire de l’effort d’armement. Et cet effort d’armement fonctionne de façon mimétique car les nationalismes fonctionnent en miroir. Malheureusement, ce réarmement fait basculer aussi vers la guerre, comme on le voit depuis quelques années…/…
*Docteur en géopolitique (HDR), ingénieur général des Ponts, des eaux et des forêts, Pierre Blanc est enseignant-chercheur en géopolitique. Ses recherches et ses enseignements à Bordeaux sciences agro et sciences po Bordeaux portent sur la géopolitique, la géopolitique du Proche-Orient et sur la géopolitique des dynamiques agraires dans cette région et dans le monde. Il est rédacteur en chef de la revue internationale « Confluences Méditerranée » (Revue Confluences Méditerranée | Cairn.info) et directeur de La Bibliothèque de l’Iremmo. Il est membre de La CERCA (Cellule de Réflexion Chrétienne sur l’Actualité du diocèse d’Aire et Dax) et dans ce cadre a travaillé ce texte qui se trouve en intégralité sur le site de J&P France et dont vous trouverez ici un extrait portant sur les nationalismes.


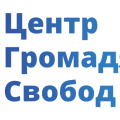

 Image par veronoumea de Pixabay
Image par veronoumea de Pixabay 