COP 16 et peuples autochtones
Le 1er novembre s’est achevée à Cali en Colombie la 16e Conférence des Nations Unies sur la biodiversité, créée en 1992, dont l’objectif principal est de promouvoir des mesures permettant un avenir durable en sauvegardant la biodiversité.
Le secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a rappelé à quel point l’effondrement de la biodiversité constitue une « crise existentielle » … « Près d’une espèce d’arbre sur trois est menacée d’extinction, les populations de vertébrés sauvages déclinent de manière extrêmement forte et les trois quarts des terres de la planète ont été altérés, le tout en raison des activités humaines. … Pour survivre, l’humanité doit transformer son modèle économique et la façon dont elle produit et consomme ».
Plusieurs décisions historiques ont été prises à Cali, dont les premiers accords sur les données génétiques de la nature, et sur la reconnaissance des personnes d’ascendance africaine et des peuples autochtones en tant que responsables clés des efforts de conservation et de l’utilisation durable de la diversité biologique. Ce dernier accord reconnaît la participation pleine et effective des peuples autochtones sur la base de leurs connaissances, de leurs innovations, de leurs technologies et de leurs pratiques traditionnelles pour atteindre les objectifs de la Convention.
Depuis une dizaine d’années, des réseaux ecclésiaux se sont créés avec comme objectif la promotion de la dignité et des droits des peuples originaires : le premier créé en Amazonie (le REPAM, en 2014) a engendré la naissance d’autres réseaux dans le Bassin du Congo, en Amérique centrale, dans le Gran Chaco, en Asie et Océanie. Ils sont réunis en Alliance pour porter au niveau mondial l’importance de connaître, suivre et soutenir les peuples indigènes dans ce qu’ils peuvent apporter à l’avenir de l’humanité par leurs connaissances et leurs pratiques, avec le soutien du Pape François.
Si les membres de la COP 16 ont échoué à obtenir un accord sur le financement du plan adopté à Montréal en 2022, 200 milliards de dollars par an pour stopper la destruction de la nature d’ici 2030[1], ils ont en revanche adopté la mise en œuvre d’un fonds multilatéral censé être abondé par les entreprises faisant des bénéfices grâce au génome numérisé de plantes ou d’animaux originaires des pays en développement. Ces données, issues souvent d’espèces présentes dans les pays pauvres, sont utilisées dans la fabrication de médicaments ou de cosmétiques qui peuvent rapporter des milliards de dollars. Mais peu de bénéfices tirés de ces données génétiques reviennent aux communautés d’origine.
Placé sous l’égide de l’ONU, le fonds « de Cali » répartira l’argent, moitié pour les pays, moitié pour les peuples autochtones. Le montant qui sera réellement collecté, principalement via des contributions volontaires, reste incertain.
Une autre question est restée sans réponse : celle d’un mécanisme de suivi permettant de mesurer les progrès accomplis par les pays dans la mise en œuvre de la feuille de route pour la protection de la biodiversité.
La société civile a participé activement aux travaux à partir de sa « zone verte » promue par la présidence colombienne de la COP. Une coalition « paix avec la nature » a été mise en place et il a été possible de mobiliser la campagne d’éducation peut-être la plus importante de l’histoire de la Colombie et de voir tant de gens s’enthousiasmer pour la biodiversité.
[1] Comme à Bakou pour la COP 29, la question des finances, fondamentale, reste une grosse pierre d’achoppement, les nations riches refusant d’assumer leurs responsabilités historiques dans la dégradation de la biodiversité et du climat.

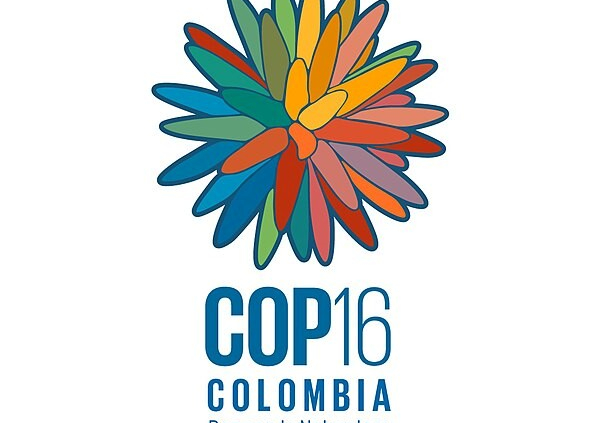 © Ministry of Environment of Colombia - https://commons.wikimedia.org/
© Ministry of Environment of Colombia - https://commons.wikimedia.org/ CC 2.0 Image par ejaugsburg
CC 2.0 Image par ejaugsburg CC 2.0
CC 2.0 Bora-Bora © Pixabay
Bora-Bora © Pixabay Image par annca de Pixabay
Image par annca de Pixabay