Pour les Mélanésiens qui l’habitent depuis des millénaires, c’est le Kanaky.
Pour les français de métropole, c’est un territoire d’outre-mer, avec son statut particulier qui lui accorde beaucoup d’autonomie. Mais c’est aussi, et en particulier pour les dirigeants français, un des signes de la grande puissance française dans le monde.
Pour des raisons aujourd’hui essentiellement géopolitiques (garder la Chine à distance et posséder des eaux territoriales immenses), les autorités semblent vouloir en faire un territoire définitivement partie intégrante de la France. Les Mélanésiens s’opposent à cette vision qui les éloigne de leur souveraineté.
Le projet de réforme électorale a rallumé les braises d’un conflit refoulé. Et le transfert et l’incarcération en métropole de leaders indépendantistes plus radicaux ne peuvent manquer de rappeler ceux du général haïtien Toussaint Louverture emprisonné au fort de Vaux ou en sens inverse ceux de militants kabyles réclamant l’indépendance et envoyés en Nouvelle Calédonie.
On peut craindre d’y voir le signe d’une résurgence coloniale. L’avenir du Kanaky peut encore être pensé de manière harmonieuse entre les leaders mélanésiens traditionnels et la puissance coloniale pour un pays souverain associé à la France.
Encore faut-il commencer à écrire cette nouvelle page.
Télécharger la Lettre n°304 septembre 2024 (PDF)
La Conférence européenne des commissions Justice et Paix (Justice et Paix Europe) a tenu ses journées d’étude et son assemblée générale à Tirana (Albanie) du 16 au 20 septembre dernier.
Cette rencontre a été marquée par la célébration des 40 ans du réseau ainsi que la fin de la présidence française (2008-2011). L’occasion de faire un petit tour d’horizon au moment où Mgr William Kenney, évêque auxiliaire de Birmingham, succède à Mgr Defois.
Un peu d’histoire
A la suite de la publication de l’encyclique de Paul VI Populorum Progressio, les conférences épiscopales de l’Europe de l’Ouest ont voulu s’engager dans la dynamique Justice et Paix en créant à leur tour des commissions au niveau national.
Dès 1971, ces commissions naissantes ont senti la nécessité de tisser des liens entre elles, d’échanger des expériences, de mettre en place des coopérations et ont créé à cet effet un comité permanent. Avec la fin de la guerre froide, une nouvelle étape a été franchie. La chute du Mur permettait de travailler au rapprochement des peuples en Europe et les commissions Justice et Paix ne se sont pas dérobées à leur responsabilité : elles ont apporté leur soutien, y compris financier, aux conférences épiscopales qui désiraient mettre en place leur propres commissions Justice et Paix. Sur la suggestion du cardinal Etchegarray, la Conférence européenne des commissions Justice et Paix est née et a accueilli en son sein les nouvelles structures. Elle compte aujourd’hui 30 commissions réparties sur l’ensemble de l’Europe.
Au fil des présidences successives, les coopérations se sont renforcées, le sentiment de partager un destin commun s’est approfondi. La présidence allemande (2005-2008) a proposé en ce sens de nouvelles méthodes de travail assumées par la présidence française : actions concertées qui permettent aux 30 commissions de faire entendre une même voix auprès de leurs responsables politiques respectifs sur une question à dimension européenne et à la présidence de Justice et Paix Europe de la relayer auprès des institutions de l’Union européenne et du Conseil de l’Europe ; journées d’étude qui permettent d’aller à la rencontre des personnes et de mieux connaître le contexte dans lequel la commission hôte de l’assemblée générale travaille ; séjour d’immersion qui donnent un visage concret aux combats menés.
Priorité à la solidarité
Justice et Paix Allemagne a fait de la réconciliation le thème central de ses trois années de présidence de la conférence européenne. La situation en Irlande du Nord, la question du Kosovo, la crise géorgienne, le problème basque et bien d’autres situation encore rappelaient alors, s’il en était besoin, que la réconciliation et la paix entre les peuples demeure l’horizon.
Mais aborder ces questions de façon directe, voire frontale, ne va pas de soi, même au sein des commissions Justice et Paix. Quelques tensions apparues au sein du réseau sur ces questions ont amené la présidence française à aborder la question différemment et à renouer avec l’intuition fondamentale des pères de l’Europe : la réconciliation et la paix ne peuvent prendre corps si nous ne créons pas également des solidarités qui cimentent notre désir de vivre ensemble sur le continent européen et, au-delà, avec le reste du monde. Travailler à la réconciliation, c’est poser le choix de la solidarité. « L’Europe comme projet solidaire » est ainsi devenue la boussole de ces trois années de présidence française. Nous avions alors prévu de décliner ce thème autour de trois défis : le défi d’inventer de nouvelles solidarités économiques, le défi politique du dépassement des conflits et enfin, le défi de l’ouverture spirituelle et culturelle à l’heure du brassage des populations.
Au cœur de l’actualité
C’est peu dire que ces défis ont été plus que jamais d’actualité durant notre mandat.
Lorsque nous sommes arrivés à la présidence, éclatait la crise financière et économique, dans laquelle nous nous débattons depuis trois ans. Cette crise n’est pas seulement la fin d’un cycle mais met en évidence les signes de contradiction d’un système qui s’est emballé et dont on ne sait plus bien qui maîtrise quoi. Nous avions pu croire un instant à une prise de conscience massive des failles du système et à une réelle volonté de prendre les mesures draconiennes qui s’imposaient pour le réformer. Un instant, nous nous prenions à espérer un retour du politique dans le pilotage de l’économie mondiale. Mais passées les mesures d’urgence pour éviter l’effondrement général du système, les premiers signes de reprise remettaient à un futur hypothétique la réforme en profondeur du système. Nous assistons depuis lors, impuissants, à la dégradation de la situation dans un monde miné par la défiance que dénonce le pape Benoît XVI dans son encyclique Caritas in Veritate. Malgré des efforts considérables des Etats européens pour s’entraider, c’est tout le processus de construction européenne qui semble à la merci des marchés. 60 ans de patients et difficiles efforts pour tisser des liens entre les ennemis d’hier, pour intégrer des partenaires nouveaux, pour mettre en place des mécanismes de solidarité qui pourraient ainsi être réduits à néant.
Dans le même temps ces derniers mois, nous avons vu souffler un vent nouveau de liberté sur les pays d’Afrique du Nord. Le « printemps arabe » a fait naître beaucoup d’attentes, beaucoup d’espoir. Nous sommes au défi de soutenir les populations, sans vouloir imposer nos solutions. L’Europe mieux que d’autres peut-être, sait ce qu’il en coûte pour faire advenir l’État de droit et la démocratie. Cette expérience douloureuse a été précieuse lorsqu’il a fallu accueillir au sein de l’Union des pays fraîchement sortis de la dictature et de régimes autoritaires à l’Ouest comme à l’Est.
Défi encore, dans les soubresauts de l’histoire, de tisser des relations de respect et de solidarité entre religions et cultures différentes. Les manipulations politiques des religions, des communautés linguistiques ou autres ne sont pas rares, les régimes pouvant être tentés de jouer les uns contre les autres. Parfois, la situation peut amener les acteurs religieux à développer davantage la capacité de résistance que de réconciliation et de solidarités nécessaires à construire un avenir pour tous.
L’engagement de Justice et Paix
Face à ces situations, Justice et Paix n’a évidemment pas la prétention de détenir la solution miracle. Les moyens d’action de nos commissions sont limités. Mais nous avons essayé de cultiver une place spécifique au sein de l’Eglise et de la société.
Nos commissions ont vocation à être des acteurs de la pensée sociale de l’Eglise. Non seulement nous contribuons à la réception des textes magistériels comme nous l’avons fait lors de la publication de l’encyclique Caritas in Veritate. Mais, par les compétences multiples que nous rassemblons à travers nos membres et malgré nos structures légères, nous avons une approche de terrain, de proximité qui nous permet d’être attentifs aux signes des temps que le Concile nous invite à scruter. Nous avons ainsi un rôle de vigilance pour exprimer le cri des plus pauvres et de tous ceux qui sont victimes d’injustice. Nos rencontres, nos journées d’étude annuelles, nous conduisent sans cesse à interroger nos responsabilités de chrétiens dans la transformation du monde. Cela ne va pas de soi. Toutes les commissions le reconnaissent : leurs travaux, et plus largement l’ensemble de l’enseignement social de l’Eglise sont souvent ignorés du Peuple de Dieu. Bien plus, à ce manque d’information, s’ajoute souvent un manque d’intérêt pour la pensée sociale de l’Eglise. Une certaine méfiance à l’égard des questions socio-économico-politique se développe dans nos milieux chrétiens. Ces questions ne seraient pas du ressort de l’Eglise qui devrait se concentrer sur la nouvelle évangélisation. C’est oublier un peu vite la position du synode des évêques de 1971 affirmant que les questions de Justice et de Paix sont constitutives de l’évangélisation (§6); position réaffirmée avec force par Benoît XVI dans Caritas in Veritate qui écrit : Le témoignage de la charité du Christ à travers des œuvres de justice, de paix et de développement fait partie de l’évangélisation (§15).
Nous sommes des acteurs d’une doctrine sociale en constante élaboration, soucieuse de s’incarner dans les préoccupations des hommes et des femmes de ce temps, soucieuse d’incarner l’Evangile dans la vie sociale.
Un travail de plaidoyer
C’est ce que nous avons cherché à faire durant ces trois dernières années.
En 2008, nous avons attiré l’attention sur la réalisation des objectifs du millénaire, et notamment le premier d’entre eux qui vise réduire l’extrême pauvreté de moitié entre 2000 et 2015. Au-delà d’une déclaration, des artistes se sont associés à notre démarche pour exprimer leur préoccupation. Leurs œuvres, réunies dans un livre, ont été exposées pour partie au Conseil de l’Europe à Strasbourg. Le secrétaire général de l’époque, M. Terry Davis, nous a soutenus dans ce combat qui constitue une priorité pour cette institution.
Plus tard, lors de notre assemblée générale de 2009, nous sommes allés à la rencontre des migrants qui rêvent d’un avenir meilleur en Europe mais se retrouvent bloqués dans l’enclave espagnole de Ceuta, au nord du Maroc. Dans un ultime geste d’espoir, ils tentent la traversée du détroit de Gibraltar, au péril de leur vie. Nous avons prié sur la plage d’Algésiras, là où deux jours auparavant, un bateau avait sombré. Nous avons témoigné à notre retour et travaillé avec d’autres ONG sur cette question.
L’année suivante, nous avons réfléchi avec nos partenaires africains sur les recommandations du synode pour l’Afrique. Migrations, exploitations des ressources naturelles, démocratie, autant de champs qui sont sources de souffrance et où nous pouvons contribuer à construire des solidarités.
Enfin, partager la vie de victimes de la traite des êtres humains en Ukraine, ou de migrants en banlieue parisienne pendant quelques jours pour comprendre leur situation de l’intérieur et découvrir les innombrables richesses dont ils font preuve pour vivre ou survivre : cela peut paraître dérisoire et pourtant… Ces séjours d’immersion nous ont permis d’instaurer des relations suivies avec les services spécialisés du Conseil de l’Europe sur la traite et de donner un visage à ces drames que l’on aborde trop souvent que par le biais des statistiques.
Avec détermination, les commissions Justice et Paix continueront à construire ce monde plus fraternel auquel nous aspirons tous… Bon vent à la nouvelle présidence.
En période de crise, il est souvent plus facile de réagir que de réfléchir. Or c’est bien dans ces moments que nous devrions réfléchir.
Ceux qui s’intéressent à la justice et à la paix sont encore plus concernés.
Dans de nombreux pays, nous allons vers des années d’austérité du fait de la recapitalisation à venir de nos banques. Des États ont réduit les prestations des services publics, ce qui presque toujours signifie que ce sont les pauvres qui en paieront le prix.
Nous sommes nombreux à être en colère, à développer un sentiment de dégoût envers les banquiers, les personnes engagées professionnellement dans les activités financières, et, au Royaume Uni, envers certains parlementaires. Dans notre colère, nous voulons la justice et peut- être même la revanche. Nous allons ainsi facilement oublier notre mission de paix.
Dans cette situation, nous devons rappeler à tous que c’est nous, hommes et femmes créés à l’image et à la ressemblance d’un Dieu de pitié, qui devons être au centre des structures politiques, économiques et ecclésiales de nos sociétés. Et nous agissons même si cela implique que j’en serai appauvri, que mon groupe social souffrira.
Ce qu’il nous faut aussi, c’est pardonner. Cela vient compléter la générosité du don de tout ce que je suis et je dois appeler toutes les femmes et tous les hommes à la réconciliation. Nous devons vouloir la réconciliation même avec ceux qui ont créé nos difficultés.
C’est en allant vers tous que nous sommes crédibles et nous avons tous besoin de pardon. Nos frères et sœurs croiront aussi à la possibilité de la Justice et de le Paix lorsque nous montrerons un véritable esprit de pardon.
Justice et Paix France présente ce texte sur le terrorisme comme un outil de réflexion. Paru en 2005, il garde toute son actualité et porte un éclairage sur les questions complexes que soulève le terrorisme

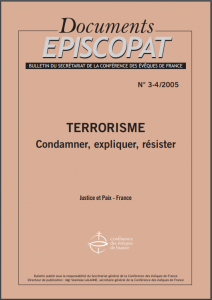
 Image par Free-Photos de Pixabay
Image par Free-Photos de Pixabay 

