Pour les Mélanésiens qui l’habitent depuis des millénaires, c’est le Kanaky.
Pour les français de métropole, c’est un territoire d’outre-mer, avec son statut particulier qui lui accorde beaucoup d’autonomie. Mais c’est aussi, et en particulier pour les dirigeants français, un des signes de la grande puissance française dans le monde.
Pour des raisons aujourd’hui essentiellement géopolitiques (garder la Chine à distance et posséder des eaux territoriales immenses), les autorités semblent vouloir en faire un territoire définitivement partie intégrante de la France. Les Mélanésiens s’opposent à cette vision qui les éloigne de leur souveraineté.
Le projet de réforme électorale a rallumé les braises d’un conflit refoulé. Et le transfert et l’incarcération en métropole de leaders indépendantistes plus radicaux ne peuvent manquer de rappeler ceux du général haïtien Toussaint Louverture emprisonné au fort de Vaux ou en sens inverse ceux de militants kabyles réclamant l’indépendance et envoyés en Nouvelle Calédonie.
On peut craindre d’y voir le signe d’une résurgence coloniale. L’avenir du Kanaky peut encore être pensé de manière harmonieuse entre les leaders mélanésiens traditionnels et la puissance coloniale pour un pays souverain associé à la France.
Encore faut-il commencer à écrire cette nouvelle page.
Télécharger la Lettre n°304 septembre 2024 (PDF)
1 – Une politique en vrac
Il ne s’agit pas distribuer les bons ou mauvais points, laissons ce jugement aux acteurs directs et aux commentateurs avisés. La situation actuelle est due à la faiblesse des débats politiques, depuis déjà de nombreuses années. En l’absence de programmes à moyen et long terme, on a au mieux des catalogues de mesures disparates et plus souvent encore des jeux de posture tactique, avec des propos violents qui disqualifient la parole politique. Il ne s’agit pas d’accabler les personnes investies, elles montrent souvent une bonne volonté, mais l’état actuel du système fait qu’elles n’ont guère la possibilité de déployer leurs capacités. Alors, mobilisons notre engagement citoyen pour rappeler aux élus leur mission de service du bien commun, ce qui suppose de leur part un vrai sens des responsabilités. Pour notre part contribuons à l’élaboration d’une parole politique digne de ce nom en précisant les perspectives d’une vie commune juste et fraternelle. Une modeste contribution sera jointe à la prochaine livraison de DIÈSE, le fuit d’un travail en atelier à propos des droits humains.
2 – Réouverture de Notre-Dame de Paris
Après la catastrophe de l’incendie, nous pouvons nous réjouir de la qualité et de la rapidité de la restauration. Un travail fantastique dû à une remarquable mobilisation financière et surtout qui a mis en lumière des compétences multiples, ainsi que des capacités d’organisation permettant de tenir un planning serré. Les contributions professionnelles et monétaires ont montré l’attachement fort à ce monument affecté au culte catholique. De nombreux témoignages évoquent le fait qu’une telle implication ouvre des perspectives permettant de donner sens au quotidien habituel. La mise en œuvre de riches compétences et la volonté d’un vrai travail en commun ont permis aux acteurs de vivre des expériences spécifiques, sans doute fort variées et propres à la conscience de chacun(e) ; une certaine pudeur à ce propos est bienvenue, même s’il est bon de partager ce que l’on vit intensément…
Mais il y a toujours une polémique en embuscade ! Alors, faudra-t-il payer pour entrer à Notre-Dame ? Au vu des foules attendues, les calculettes prennent un coup de chaud, en raison de perspectives plus ou moins mercantiles. On sort alors un critère qui paraît imparable avec l’opposition entre culte et culture : tu viens pour prier, c’est gratuit ; tu viens pour admirer, tu payes ! C’est net et bien tranché, au risque d’oublier la richesse (et donc la complexité) de nos démarches humaines ; un exemple, pour apprécier des vitraux ou des sculptures il n’est pas inutile de connaître quelque peu l‘héritage chrétien.
Je propose d’introduire un troisième terme plus fluide : la dimension spirituelle. Pour les personnes qui se réfèrent à la foi chrétienne, l’ambiance générale dans la cathédrale, mais aussi les décors et l’orgue, peuvent être des atouts précieux. Pour celles qui se situent comme agnostiques ou proches d’une autre religion, un tel édifice peut soutenir une expérience susceptible d’éclairer et même d’orienter leur propre existence. J’ose dire que des lieux de ce type rendent un service au public, en permettant à des visiteurs cultuels et/ou culturels de se poser, de mieux se situer dans leur vie.
Une entrée libre induit que la personne qui arrive peut se sentir chez elle en ce lieu (ce qui explique l‘attachement d’un grand nombre – de convictions diverses – à Notre-Dame), tandis que la médiation d’un ticket payant semble correspondre au droit de passer la porte d’un étranger. Il est bon que chacun puisse venir se poser sans qu’on lui demande des comptes.
3 – Parlons démographie
+ Il y a peu, le nombre de naissances dans le monde était vu comme un péril ; cette peur redoublait même en raison des défis écologiques : comment la terre pourrait-elle nourrir autant de bouches ? Aujourd’hui, l’inquiétude se déporte vers la baisse de la natalité. Un continent comme l’Europe entrevoit le vieillissement et la diminution de sa population ; un grand pays comme la Chine se trouve déjà en recul démographique ; certes, quelques pays, notamment en Afrique, continuent d’être en expansion. Un premier étonnement : la question démographique demeure largement absente des débats concernant les migrations, alors que des pays dits développés devront bien accueillir des personnes venant de l’étranger pour assurer les services de la vie quotidienne. Le propos n’est pas d’offrir une vision exhaustive sur l’ensemble de ces problèmes. Il s’agit, plus modestement, d’interroger la manière souvent étroite dont ces questions se trouvent actuellement posées.
+ Le vocabulaire concernant la démographie parle plus généralement en termes de flux et de stocks, comme s’il s’agissait de matières premières tirées du sol. Ou alors on s’en tient à une approche strictement économique à partir du modèle avantages/coûts : même si on n’ose pas trop parler du « prix » d’un bébé ou d’un vieillard, le regard mercantile n’est jamais loin. Or, il s’agit de donner la vie, de l’accueillir et de la servir à tout âge. Ce n’est pas abstrait, il s’agit bien de l’existence d’êtres humains tout à fait concrets ! Ils ont des besoins, certes, mais aussi et surtout des désirs : le goût de vivre des relations riches, sous le signe d’un amour partagé. Aussi, en ce domaine, l’approche symbolique semble bien plus pertinente que les simples analyses en termes de marchés (coût de l’école et des maisons de retraites…).
Il nous faut sortir d’un piège à deux faces sous le mode d’injonctions : pour les uns, nécessité de faire des enfants ; pour d’autres, la fécondité constitue une menace. Il y a d’abord un enjeu de confiance en la vie, osons dire de « foi », c’est-à-dire d’une espérance qui déborde toute approche réduite à de simples calculs. Une foi qui ouvre la voie à l’émerveillement d’accueillir une personne nouvelle, à nulle autre pareille, qui va apporter une note originale dans le concert de notre vie commune. Une telle perspective a aussi une dimension politique : portons-nous ensemble le désir d’une heureuse vie commune, au point de désirer la partager, en nous réjouissant d’accueillir de nouveaux convives à notre table ?
4 – Noël sous le signe de paix, notamment pour les enfants
Il est bon de nous réjouir en préparant le fête de Noël et de voir des étoiles dans les yeux des enfants. Mais nous ne pouvons oublier les enfants qui souffrent et qui meurent, en raison des armes, des famines provoquées, des maladies non soignées… en Ukraine, au Moyen Orient, en Afrique… Nous ne pouvons oublier les pleurs des enfants, la détresse de parents démunis face à ces drames. Nous savons aussi que dans les pays riches, à commencer par le nôtre, des enfants vivent dans l’extrême pauvreté, sont soumis à des violences…
Alors, y compris dans une période de fêtes, n’oublions pas de travailler à la justice et à la paix, de promouvoir les droits humains : il y a de quoi inspirer des programmes politiques !
Télécharger le n°75 dec 24 (PDF)
La question du désarmement, nucléaire en particulier, revient régulièrement à la une, ces temps-ci face aux menaces répétées du président de la Fédération de Russie d’utiliser l’arme nucléaire pour faire face aux velléités de l’Ukraine et de ses alliés.
On ne peut pas simplement courber l’échine ou fermer ses oreilles. Il faut en parler.
La France et le Royaume Uni, les deux puissances nucléaires européennes, ont signé en 2010 un traité par lequel elles ont décidé entre autres de travailler sur la mise en œuvre de leurs engagements pris dans le cadre du Traité de non-prolifération nucléaire de réduire leur armement nucléaire et d’aller vers un désarmement total.
Le contexte actuel freine cet élan, mais faut-il l’oublier ?
Le Pape François appelle régulièrement au désarmement. Nous relayons ici son appel et invitons les autorités britanniques et françaises à prendre un tant soit peu en considération le Traité d’Interdiction des Armes Nucléaires dont le Saint Siège a été promoteur.
Michel Roy, Secrétaire Général de Justice et Paix France
Déclaration conjointe de 11 organismes signataires et le soutien de 22 autres :
26 novembre 2024
A l’occasion de l’anniversaire du Traité de coopération en matière de défense et de sécurité entre le Royaume Uni et la République française (« Traités de Lancaster House/Teutates »).
Aujourd’hui, neuf pays détiennent 12 121 armes nucléaires, lesquelles représentent pour l’humanité une menace aussi grave que celles que font peser le dérèglement climatique ou l’effondrement de la biodiversité. En effet l’explosion de quelques unes d’entre elles dans le cadre d’un conflit, même géographiquement limité, pourrait conduire à une catastrophe environnementale généralisée, sans négliger le nombre de victimes humaines qu’elle provoquerait.
L’attribution du prix Nobel de la paix 2024 à l’organisation japonaise Nihon Hidankyo pour son combat contre l’arme atomique vient nous rappeler l’horreur des souffrances humaines qu’entraînerait immanquablement toute utilisation de ces armes terrifiantes. Les membres du comité Nobel font état de leur préoccupation quant à un risque accru de déclenchement d’un tel cataclysme.
De plus, les dépenses mondiales engagées pour leur production et leur maintenance sont considérables, estimées annuellement à plus de 90 milliards de dollars (plus de 80 milliards d’euros), soit plus de 150 000 euros par minute. Des sommes faramineuses qui pourraient être investies dans l’éducation, la santé ou la lutte contre la misère, et permettre ainsi d’atteindre les objectifs de développement durable (ODD) fixés par l’ONU pour 2030.
Quant à leur utilité, elle relève sans doute davantage d’une croyance illusoire que d’une réelle efficacité de leur aspect dissuasif. Ainsi les armes nucléaires détenues par les pays de l’OTAN n’ont pas empêché l’agression de l’Ukraine par la Russie. Peut être même les armes détenues par cette dernière ont elles autorisé Vladimir Poutine à engager cette guerre, au risque de la voir devenir un conflit nucléaire mondial ?
C’est dans ce contexte préoccupant que, à l’occasion du 14ème anniversaire de la signature des Traités de Lancaster House/ Teutates, le 2 novembre 2010, entre la Grande Bretagne et la France, nous rendons publique cette déclaration signée par des représentants chrétiens de ces deux pays. Ces Traités évoquent un «partenariat à long terme mutuellement bénéfique en matière de défense et de sécurité » et prévoient d’utiliser en commun les installations de Valduc (France) et Aldermaston (Grande Bretagne) pour modéliser et améliorer les performances de leurs ogives nucléaires, tout en reconnaissant que «la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs est l’une des menaces les plus graves pour la paix et la sécurité internationales» . Ces Traités affirment aussi que les deux pays œuvreront « à renforcer le Traité de non prolifération nucléaire, l’une des pierres angulaires de l’architecture de sécurité internationale, et soutiendront les efforts en cours dans ses trois piliers : la non prolifération, l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire et le désarmement ».
Quatorze ans après, il apparaît que nos deux pays n’ont pas réellement fait de pas dans cette direction.
Nous souhaitons donc saisir l’occasion de cet anniversaire pour exhorter les dirigeants et gouvernements britanniques et français à prendre vraiment des mesures significatives, et vérifiables, pour enfin honorer leur engagement à un désarmement nucléaire, mentionné dans l’article VI du Traité de non-prolifération (TNP) dont nos deux pays sont États parties. Nous les encourageons aussi à adopter une attitude plus constructive à l’égard du Traité sur l’interdiction des armes nucléaires (TIAN) entré en vigueur le 22 janvier 2021, en annonçant leur participation comme observateurs à la prochaine réunion des 94 pays l’ayant déjà signé ou ratifié, le Saint Siège ayant été l’un des un des promoteurs de ce traité. Le TIAN est en effet présenté par ses signataires comme une application concrète de l’article VI du TNP.
Notre déclaration est conforme à l’enseignement de l’Église catholique, réaffirmé clairement et avec gravité en de multiples occasions depuis le début de ce siècle, et particulièrement par les papes Benoît XVI et François. Elle se veut aussi le prolongement du document ‘‘Called to be Peacemakers: A Catholic approach to arms control and disarmament’’1 publié récemment par les évêques catholiques d’Angleterre et du Pays de Galles, , qui invite le gouvernement britannique à renoncer à terme à son arsenal nucléaire afin de contribuer à l’émergence d’un monde dénucléarisé, conformément aux obligations prises lors de la ratification du TNP. Ce document invite également les dirigeants britanniques à participer comme observateurs aux prochaines réunions des signataires du TIAN, puis à signer et ratifier ce Traité, permettant alors de réorienter les dépenses consacrées aux armes nucléaires vers le champ social, promouvant ainsi le bien commun universel.
Dans une déclaration commune publiée en 2023, les dirigeants de nos deux pays réitèrent leur nos deux pays réitèrent leur opposition au TIAN au prétexte qu’’il « ne reflète pas pas l’environnement de sécurité international de plus en plus difficile et est en contradiction avec l’architecture existante de non-prolifération et de désarmement ». Or on ne peut pas affirmer que le TIAN serait « en contradiction avec l’architecture existante de non–prolifération » à partir du moment où c’est précisément le TNP, que nos pays veulent défendre, qui préconise la non-prolifération et le désarmement. Le TIAN ne fait que porter cette logique à sa conclusion inéluctable.
À son retour d’’Hiroshima, en novembre 2019, le pape François a réaffirmé que « l’utilisation d’armes nucléaires est immorale (…) et pas seulement leur utilisation, mais aussi leur possession, car un accident [dû à] cette possession ou à la folie d’un dirigeant (…) peut conduire à la destruction l’humanité ». Cette parole nous invite à ne pas nous taire, au risque sinon que les pierres elles. ne crient (Luc 19, 40).
[1] https://www.cbcew.org.uk/wp-content/uploads/sites/3/2024/05/Called-to-be-Peacemakers.pdf
Signataires
– Action des chrétiens pour l’abolition de la torture ACAT France (Yves Rolland, Président)
– Anglican Pacifist Fellowship (Sue Claydon, chair)
– Centre de recherche et d’action sociales CERAS (Marcel Rémon, Directeur)
– CCFD – Terre Solidaire ( Virginie Amieux, Présidente)
– Commission Justice et Paix – France (Michel Roy, Secrétaire général)
– Communauté Mission de France – CMdF (Henri Védrine, Vicaire Général)
– Cymdeithas y Cymod – Fellowship of Reconciliation, branche galloise de l’IFOR (Peter Cutts, membre du Comité Exécutif)
– Fellowship of Reconciliation, branche anglaise et écossaise de l’IFOR (John Cooper, Director)
– Mouvement International de la Réconciliation – MIR, branche française de l’IFOR (Josette Gazzaniga et Augustin Nkundabashaka, co-présidents)
– Pax Christi – England and Wales (Andrew Jackson, Chief executive)
– Pax Christi – France (Alfonso Zardi, Délégué général)
Avec le soutien de
– Abolition des armes nucléaires – Maison de Vigilance (Denis Stienne, membre du Bureau)
– Agir pour le Désarmement Nucléaire – ADN Franche–Comté (Pierre Jacquin(Pierre Jacquin-Porretaz, Président)
– Cardiff Stop the War Coalition (Adam Johannes, Joint Secretary)
– Collectif Bourgogne-Franche-Comté pour l’abolition des armes nucléaires (Anne-Béatrice Béatrice Scherrer, porte-parole)
– Campaign for Nuclear Disarmament – CND Cymru (Jill Evans, Vice Chair)
– Démocratie & Spiritualité (Daniel Lenoir, Président)
– Greenham Women are Everywhere (Alison Lochhead, Convenor)
– Heddwch ar Waith (Sam Bannon, Coordinator)
– ICAN-France, Campagne Internationale pour l’abolition des armes nucléaires, organisation prix Nobel de la Paix 2017 (Jean–Marie Collin, Directeur)
– Initiatives pour le Désarmement Nucléaire IDN (Général Bernard Norlain, Président)
– Les Amis de la Terre – France (Marie Cohuet et Laura Thieblemont, coprésidentes)
– Movement for the Abolition of War (Hilary Evans, Committee Member)
– Mouvement de la Paix (Roland Nivet, porte-parole national)
– Mouvement pour une Alternative Non-violente – MAN (Comité d’Animation)
– Peace Pledge Union (Ed Bridges, Committee Member)
– Trident Ploughshares (Angie Zelter, member)
– Université Européenne de la Paix – UEP (Roland de Pénanros, Président)
– Guy Aurenche, avocat honoraire, ancien président de l’ACAT et du CCFD -Terre solidaire
– Mayeul Kauffmann, Président de l’Institut de recherche sur la Résolution Non-violente des Conflits (IRNC)
– Christian Mellon, jésuite, membre du CERAS, ancien secrétaire de la Commission Justice et Paix
– Denis Stienne, membre, Abolition des armes nucléaires – Maison de vigilance – AAN-MV
– Christian Terras, responsable éditorial de la revue Golias
Télécharger la F.GB Teutatès-TIAN FR. (PDF) déclaration à l’occasion du 14è anniversaire de la signature des Traités de Lancaster House/ Teutates le 2 novembre 2010 entre la Grande Bretagne et la France.
Le 1er novembre s’est achevée à Cali en Colombie la 16e Conférence des Nations Unies sur la biodiversité, créée en 1992, dont l’objectif principal est de promouvoir des mesures permettant un avenir durable en sauvegardant la biodiversité.
Le secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a rappelé à quel point l’effondrement de la biodiversité constitue une « crise existentielle » … « Près d’une espèce d’arbre sur trois est menacée d’extinction, les populations de vertébrés sauvages déclinent de manière extrêmement forte et les trois quarts des terres de la planète ont été altérés, le tout en raison des activités humaines. … Pour survivre, l’humanité doit transformer son modèle économique et la façon dont elle produit et consomme ».
Plusieurs décisions historiques ont été prises à Cali, dont les premiers accords sur les données génétiques de la nature, et sur la reconnaissance des personnes d’ascendance africaine et des peuples autochtones en tant que responsables clés des efforts de conservation et de l’utilisation durable de la diversité biologique. Ce dernier accord reconnaît la participation pleine et effective des peuples autochtones sur la base de leurs connaissances, de leurs innovations, de leurs technologies et de leurs pratiques traditionnelles pour atteindre les objectifs de la Convention.
Depuis une dizaine d’années, des réseaux ecclésiaux se sont créés avec comme objectif la promotion de la dignité et des droits des peuples originaires : le premier créé en Amazonie (le REPAM, en 2014) a engendré la naissance d’autres réseaux dans le Bassin du Congo, en Amérique centrale, dans le Gran Chaco, en Asie et Océanie. Ils sont réunis en Alliance pour porter au niveau mondial l’importance de connaître, suivre et soutenir les peuples indigènes dans ce qu’ils peuvent apporter à l’avenir de l’humanité par leurs connaissances et leurs pratiques, avec le soutien du Pape François.
Si les membres de la COP 16 ont échoué à obtenir un accord sur le financement du plan adopté à Montréal en 2022, 200 milliards de dollars par an pour stopper la destruction de la nature d’ici 2030[1], ils ont en revanche adopté la mise en œuvre d’un fonds multilatéral censé être abondé par les entreprises faisant des bénéfices grâce au génome numérisé de plantes ou d’animaux originaires des pays en développement. Ces données, issues souvent d’espèces présentes dans les pays pauvres, sont utilisées dans la fabrication de médicaments ou de cosmétiques qui peuvent rapporter des milliards de dollars. Mais peu de bénéfices tirés de ces données génétiques reviennent aux communautés d’origine.
Placé sous l’égide de l’ONU, le fonds « de Cali » répartira l’argent, moitié pour les pays, moitié pour les peuples autochtones. Le montant qui sera réellement collecté, principalement via des contributions volontaires, reste incertain.
Une autre question est restée sans réponse : celle d’un mécanisme de suivi permettant de mesurer les progrès accomplis par les pays dans la mise en œuvre de la feuille de route pour la protection de la biodiversité.
La société civile a participé activement aux travaux à partir de sa « zone verte » promue par la présidence colombienne de la COP. Une coalition « paix avec la nature » a été mise en place et il a été possible de mobiliser la campagne d’éducation peut-être la plus importante de l’histoire de la Colombie et de voir tant de gens s’enthousiasmer pour la biodiversité.
[1] Comme à Bakou pour la COP 29, la question des finances, fondamentale, reste une grosse pierre d’achoppement, les nations riches refusant d’assumer leurs responsabilités historiques dans la dégradation de la biodiversité et du climat.

 Dièse
Dièse
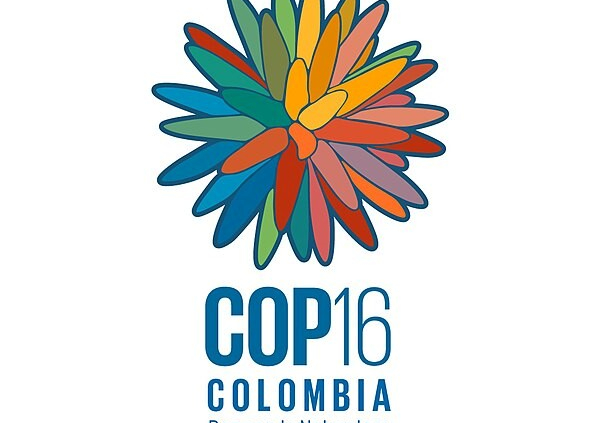 © Ministry of Environment of Colombia - https://commons.wikimedia.org/
© Ministry of Environment of Colombia - https://commons.wikimedia.org/ Image par Free-Photos de Pixabay
Image par Free-Photos de Pixabay 

