Pour les Mélanésiens qui l’habitent depuis des millénaires, c’est le Kanaky.
Pour les français de métropole, c’est un territoire d’outre-mer, avec son statut particulier qui lui accorde beaucoup d’autonomie. Mais c’est aussi, et en particulier pour les dirigeants français, un des signes de la grande puissance française dans le monde.
Pour des raisons aujourd’hui essentiellement géopolitiques (garder la Chine à distance et posséder des eaux territoriales immenses), les autorités semblent vouloir en faire un territoire définitivement partie intégrante de la France. Les Mélanésiens s’opposent à cette vision qui les éloigne de leur souveraineté.
Le projet de réforme électorale a rallumé les braises d’un conflit refoulé. Et le transfert et l’incarcération en métropole de leaders indépendantistes plus radicaux ne peuvent manquer de rappeler ceux du général haïtien Toussaint Louverture emprisonné au fort de Vaux ou en sens inverse ceux de militants kabyles réclamant l’indépendance et envoyés en Nouvelle Calédonie.
On peut craindre d’y voir le signe d’une résurgence coloniale. L’avenir du Kanaky peut encore être pensé de manière harmonieuse entre les leaders mélanésiens traditionnels et la puissance coloniale pour un pays souverain associé à la France.
Encore faut-il commencer à écrire cette nouvelle page.
Télécharger la Lettre n°304 septembre 2024 (PDF)
Deux soulèvements populaires pacifiques marquent l’actualité du continent africain. En Algérie et au Soudan, les dirigeants ont été contraints de se retirer face à la mobilisation de populations contestant un trop long maintien au pouvoir des clans présidentiels, et leur façon de gouverner.
Dans ces deux pays, l’armée a cherché à conduire la transition, après la chute d’Abdelaziz Bouteflika et d’Omar el Béchir. Dans les deux cas, la population a signifié, pacifiquement mais fermement, qu’elle entendait garder la main sur la suite des événements et exigeait justice pour les crimes commis. Dans les deux cas s’est imposé un pouvoir ne marquant ni rupture ni totale continuité. Ces deux transitions sont en cours. Leur issue reste incertaine. Le Soudan et l’Algérie – pays restés à l’écart des « printemps arabes » – témoignent de l’aspiration obstinée des peuples africains, en particulier de leur jeunesse, archi-majoritaire, à une amélioration de la gouvernance et à une alternance à la tête de l’État.
De tels changements, longtemps hors de portée, constituent aujourd’hui plutôt la règle. Ils interviennent généralement par les urnes, dans un contexte où, depuis 2010, le continent n’a jamais compté autant de pays dotés de systèmes politiques basés sur l’élection [1]. Un seul pays, une dictature, ne vote pas, même pour la forme : l’Érythrée. Pour autant, ces scrutins permettent-ils de véritables alternances démocratiques ? « On n’organise pas des élections pour les perdre », disait l’ancien président congolais Pascal Lissouba. Quand ils ne modifient pas la Constitution en vue de pouvoir rester au pouvoir, de nombreux présidents sortants choisissent leur successeur (Mauritanie, Angola, et République démocratique du Congo récemment) : des changements de têtes plus que de méthodes.
Les élections conduisent parfois à une alternance. Le cas le plus emblématique est celui de la Gambie : le brutal dictateur Yahya Jammeh, tomba en 2017 après une présidentielle qu’il croyait gagnée d’avance. Depuis cette chute inattendue, à laquelle le Sénégal, aidé de la France, a pris une part certaine, le Togo demeure le seul État ouest-africain à n’avoir jamais connu d’alternance, dirigé depuis 2005 par Faure Gnassingbé, qui succéda à son père Gnassingbé Eyadema, lui-même arrivé au pouvoir après deux coups d’État (1963, 1967).
Élections ≠ démocratie
Si la tenue d’élections est une condition sine qua non de la démocratie, celle-ci ne s’y limite pas. L’équation est résumée par les chercheurs Victor Magnani et Thierry Vircoulon [2]. À leurs yeux, la question de la démocratie en Afrique est victime d’un « double réductionnisme » : « elle est réduite à la dimension électorale – cette dimension étant elle-même réduite au fait de savoir si les élections sont libres, transparentes et régulières ». Pour les puissances occidentales et les gouvernements des pays en cause, la tenue d’élections satisfaisant à ces critères est souvent jugée suffisante pour donner un brevet de démocratie.
Cette vision néglige les aspects fondamentaux que sont l’environnement institutionnel (neutralité politique des institutions, séparation réelle des pouvoirs) et politique (accès égalitaire aux médias et aux financements de campagne…). Des présidentielles récentes (Bénin, Madagascar, Kenya…) ont donné lieu à des débauches de moyens, dont l’origine reste largement obscure. Une étude financée en 2016 par l’Union Européenne a évalué que le vainqueur de la présidentielle de 2013 à Madagascar, Hery Rajaonarimampianina, aurait dépensé 43 millions de dollars pour sa campagne victorieuse. Ces dépenses feraient de cette élection le scrutin récent le plus onéreux au monde, rapporté au nombre de voix réunies – environ 2 millions. Ce qui n’a pas empêché une même surenchère de moyens lors de la présidentielle de 2018. Cette débauche de moyens est à la mesure de l’enjeu : le contrôle d’États où les plus gros marchés sont publics, souvent attribués de gré à gré, et où la concession du sol (terres arables, terrains immobiliers) et du sous-sol (minerais) revient à l’administration.
Quand les candidats ne sont pas eux-mêmes à la tête de conglomérats [3], des entrepreneurs locaux, et parfois des États étrangers – comme la Russie récemment [4], sont prêts à financer la campagne d’un ou de plusieurs candidats dans l’espoir d’être in fine remboursés, si possible au centuple, en contrats publics ou ressources naturelles (bois précieux, minerais). Certains acteurs politiques pratiquent le renvoi d’ascenseur croisé d’un pays à l’autre : tel leader politique finance la campagne d’un candidat d’un autre pays qui, une fois parvenu au pouvoir, lui rendra la pareille. Plus classiquement, les régimes sortants abusent souvent des moyens de l’État et des trésors de guerre accumulés dans le cadre de l’exercice du pouvoir. À l’échelon local, c’est plutôt l’impunité qu’achètent des entrepreneurs de moindre envergure, en soutenant un candidat ou en se faisant élire. Ainsi des trafiquants de drogue notoires siègent dans certains parlements sahéliens, avec immunité parlementaire à la clé.
À ces phénomènes qui biaisent le scrutin, s’ajoute souvent l’absence de séparation des pouvoirs. Même organisé correctement, sans incidents graves, un scrutin arbitré par un conseil constitutionnel aux ordres du pouvoir ne sera pas réellement démocratique et débouchera parfois sur une crise. Cette absence de séparation des pouvoirs se double souvent d’une méconnaissance de la fonction même de ces pouvoirs. Dans certains pays, 100% des lois votées sont le fruit de projets émanant du gouvernement : majorité comme opposition s’abstiennent de déposer la moindre proposition de loi. C’est plus souvent le camp au pouvoir qui dévoie les institutions en les instrumentalisant. La création d’un Sénat, dont de nombreux États africains étaient dépourvus depuis leur indépendance, sert principalement à rétribuer aux frais de l’État des loyautés politiques. Loin d’être des relais du peuple souverain, ces institutions se superposent à d’autres cénacles ayant des fonctions comparables (conseil économique et social, conseil des rois et chefs traditionnels…) et offrent « l’avantage », de surcroit, d’émarger au guichet de la «coopération interparlementaire».
La tentation autoritaire ?
C’est tout ce que le jargon international appelle la « gouvernance » qui apparait en creux quand on parle d’élections. L’organisation régulière d’élections par des pouvoirs qui entretiennent un système politique déséquilibré en leur faveur ne peut suffire à définir une démocratie. Les peuples d’Afrique ne s’y trompent pas et restent, dans leurs aspirations, assez étrangers à l’assaut général contre la démocratie observé à travers le monde. Les données d’enquête d’Afrobaromètre, qui couvrent plus de 30 pays du continent, indiquent que les citoyens désirent des élections ouvertes ; leur soutien aux élections est d’autant plus fort qu’ils pensent qu’elles peuvent permettre une alternance. Alors que la participation aux élections est globalement en baisse dans le monde, elle est restée stable en Afrique ces dernières décennies.
Cela n’enlève rien à l’attrait que la « stabilité » de régimes autoritaires, tels la Chine, inspirent… surtout aux dirigeants politiques. Au-delà d’une commune absence d’aversion envers la corruption, l’image d’un modèle politique basé sur l’étatisme et le contrôle policier séduit. Sans parler de l’absence d’élection et d’alternance, à laquelle la « stabilité » sert de paravent, par opposition aux élections, assimilées à la confrontation et donc la violence. Cet argument de la stabilité, ajouté au pseudo-« appel du peuple », justifie les révisions constitutionnelles visant à prolonger les pouvoirs présidentiels en place. Depuis les années 1990, de nombreux États avaient, sous la pression populaire, inscrit dans leur Constitution une clause limitant à deux le nombre de mandats présidentiels et/ou imposant des limites d’âge. Cette règle est régulièrement remise en cause par certains dirigeants. Généralement, le motif réel est parfaitement lisible par les populations : il s’agit pour les présidents de garder – pour eux ou leur entourage – l’accès aux ressources et d’éviter d’éventuelles poursuites judiciaires.
Cette tentation de jouer les prolongations est particulièrement préoccupante dans les régimes où le problème de la succession se fait pressant du fait de l’âge du capitaine. En 2020, trois chefs d’État africains sont au pouvoir depuis plus de trois décennies : Teodoro Obiang Nguema en Guinée équatoriale, Paul Biya au Cameroun, Yoweri Museveni en Ouganda. Certains coups d’État constitutionnels ont toutefois été contrecarrés. Au Sénégal en 2012, les électeurs se sont opposés à un troisième mandat assorti d’une possible dévolution du pouvoir au fils du président. Au Burkina Faso, la tentative de maintien au pouvoir de Blaise Compaoré, en place depuis 1987, s’est heurtée en 2014 à une mobilisation populaire qui le contraignit à quitter le pouvoir. Quant aux coups d’État tout court, ils sont passés de mode : les régimes militaires se font rares en Afrique subsaharienne, et les derniers cas ont été de courte durée. Si la possibilité de l’alternance à la tête de l’État reste au cœur des préoccupations électorales, elle est indissociable des conditions générales d’exercice de la démocratie.
En Afrique comme ailleurs, les citoyens ne se reconnaissent plus, ou plus seulement, dans les partis politiques traditionnels, qui ne constituent plus une offre attractive, notamment aux yeux des moins de trente ans, archi-majoritaires dans le continent. Ce déclin des partis d’opposition s’accompagne de la montée en puissance de mouvements citoyens qui utilisent les réseaux sociaux comme espace de cristallisation des revendications sociales, économiques et politiques, et de mobilisation . Ils font émerger des figures alternatives, à l’image de Bobi Wine, jeune chanteur issu des bidonvilles de Kampala, qui éclipse les opposants politiques traditionnels en Ouganda. C’est certainement la tendance nouvelle à regarder de près dans les prochaines années, dont on ne sait encore si elle affermira la démocratie… ou l’affaiblira.
1 P. Jacquemot, « Les élections en Afrique, marché de dupes ou apprentissage de la démocratie ? », Revue internationale et stratégique, n° 2, 2019.
2 « Vers un retour de l’autoritarisme en Afrique ? », Politique étrangère, vol. 84, n° 2, 2019.
3 Cas des actuels présidents malgache Andry Rajoelina, béninois Patrice Talon, sud-africain Cyril Ramaphosa et kényan Uhuru Kenyatta.
4 « Madagascar: la Russie aurait-elle manipulé la présidentielle? », BBC, 8 avril 2019.
5 L. Duarte, « Afrique – Quand la démocratie se joue en ligne », Projet, n° 371, 2019
Les débats en vue des prochaines élections municipales mettent en jeu la politique comme exercice du pouvoir, mais aussi comme organisation de la cité au plus près de la vie des gens.
Pour en éclairer les enjeux, il vaut la peine de raviver un terme un peu abscons : la subsidiarité. Ce principe, promu par l’enseignement social de l’Église, est aussi évoqué dans des textes officiels, notamment dans l’organisation des rapports entre l’Union européenne et les États membres. Pour mesurer la fécondité de cette référence, il importe de la situer en lien étroit avec deux principes fondamentaux de l’éthique sociale : la dignité humaine et le bien commun. C’est ce que fait le pape François dans Laudato si’ : « Le bien commun présuppose le respect de la personne humaine comme telle, avec des droits fondamentaux et inaliénables ordonnés à son développement intégral. Le bien commun exige aussi le bien-être social et le développement des divers groupes intermédiaires, selon le principe de subsidiarité » (n° 157).
Le rôle positif des différents niveaux politiques et des corps intermédiaires
Dans le cadre de l’enseignement social de l’Église, la subsidiarité a été promue par Pie XI, en rapport avec la montée des totalitarismes (Quadragesimo anno, 1931, n° 88). Il s’agit d’abord de considérer positivement la responsabilité propre des différents échelons politiques, au lieu de concentrer le maximum de pouvoir au sommet de la pyramide. D’autre part, en plus de la vie économique qui bénéficie d’une large autonomie, le recours à la subsidiarité favorise l’initiative et l’action des différents corps intermédiaires (associations, syndicats, religions…) qui manifestent la vitalité du corps social : toute impulsion positive ne vient pas forcément d’en-haut !
Dignité humaine
Quelles sont les bonnes raisons de promouvoir de telles pratiques ? Il y a tout d’abord un enjeu de dignité humaine. Au nom de celle-ci, chaque personne doit pouvoir accéder à une part convenable du bien commun, afin d’avoir une vie correcte ; les situations de pauvreté dans notre pays et à l’échelle du monde rappellent que nous sommes loin du compte ! Mais la dignité comprend aussi la capacité pour chacun de participer positivement à la vie commune en y apportant sa compétence et sa créativité propres ; une société qui rejette et exclut, au point de considérer certains de ses membres comme des déchets, est, là encore, loin du compte ! Le respect de toute personne humaine comprend à la fois le droit d’accéder aux biens élémentaires et la possibilité effective de prendre une part active dans l’organisation de la vie commune. Pour assurer le déploiement de cette dignité fondée sur les droits de l’homme, il faut demeurer vigilant quand certains évoquent avec mépris un soi-disant « droit-de-l’hommisme » !
Bien commun
La mise en œuvre de la subsidiarité promeut une vie commune féconde. Selon une vue tronquée du bien commun, on confond l’efficacité politique avec l’emprise d’un collectif géré par un pouvoir central, au détriment des contributions libres et créatrices des citoyens. Ceux-ci méritent d’être reconnus comme acteurs de la vie commune, tant dans leurs initiatives individuelles que dans l’animation des corps intermédiaires. Une vue biaisée de l’autorité peut altérer gravement la qualité de la vie commune ; à l’inverse, la démocratie participative, qui ne réduit pas les corps intermédiaires à de simples contre-pouvoirs, peut contribuer à une solidarité fraternelle.
Les élections et l’engagement quotidien
Le vote, notamment à l’échelon municipal, représente un acte démocratique majeur. La démocratie, en respectant le choix du citoyen, reconnait ainsi sa dignité. Il faut cependant veiller à ce que les élus ne prétendent pas faire le bien du peuple sans lui, voire contre lui ! De plus, la vie démocratique ne se réduit pas au seul acte électoral. La participation continue à la vie de la cité – de manière créative et engagée, notamment dans les activités bénévoles – constitue un bien précieux pour la collectivité et chacun de ses membres. Au moment de voter, les engagements des candidats concernant la prise en compte des différents échelons de pouvoir et la reconnaissance effective des corps intermédiaires seront de précieux indices pour un choix éclairé. Mais chaque citoyen peut également s’interroger sur la manière dont il met en œuvre la subsidiarité dans les différents lieux où il exerce un pouvoir : au travail, dans les associations, etc.
Le christianisme social par le pasteur Jean-Pierre Rive. Une histoire passionnante…

 Image par Free-Photos de Pixabay
Image par Free-Photos de Pixabay 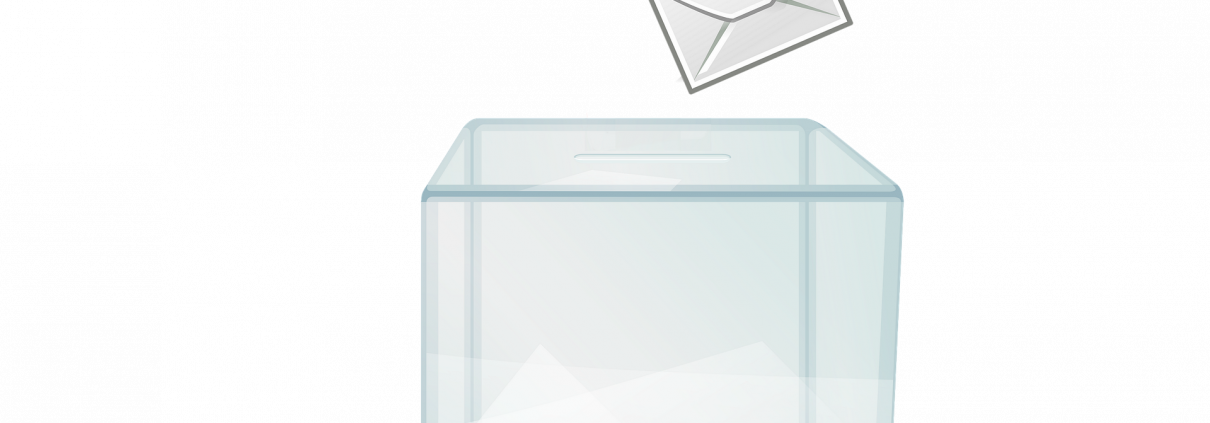 Image par Tumisu de Pixabay
Image par Tumisu de Pixabay  Image par DEZALB de Pixabay
Image par DEZALB de Pixabay 


